Ce numéro spécial du Bulletin de la Banque Royale ne péchera pas par excès de modestie. Il faut dire à sa décharge qu’il marque trois anniversaires hautement symboliques : le début de la 75e année de parution du Bulletin, la 50e année révolue de sa transformation en périodique d’intérêt général et la 125e année d’existence de la banque dont il porte si fièrement le nom.
Toujours soucieux de précision terminologique, le Bulletin serait le premier à refuser l’épithète « unique » à quelque chose dont on ne pourrait prouver qu’il « est seul de son espèce ou… n’a pas son semblable », comme le veut le dictionnaire. Si nous nous risquons à écrire qu’il est unique, c’est parce qu’à notre connaissance, il n’a pas son semblable.
Il est à vrai dire si différent des autres publications que nous savons à peine comment le dénommer. Malgré certaines ressemblances de forme, il n’a rien de commun avec les autres bulletins que publient tant d’entreprises à intervalles périodiques pour analyser ou commenter l’actualité de leur domaine d’activité. Bien qu’il porte le nom d’une grande institution financière, le Bulletin ne traite presque jamais de finances.
Aucun autre sujet ne lui est étranger, par contre, au point qu’il stupéfie parfois le lecteur novice qui s’attendait à un traité sobre jusqu’à la monotonie, conforme à l’image classique du banquier. Ces dernières années, le Bulletin a disserté sans complexe sur le professionnalisme et les petits animaux de compagnie, les collectionneurs et les bons conducteurs, l’âge mûr, l’amitié, les ordinateurs. Il a raconté la vie de grands explorateurs et de chefs politiques, a décrit des états d’âme et d’esprit comme la peur et la loyauté…
Une telle panoplie de sujets suggère le magazine, mais cette hypothèse ne résiste pas non plus à l’examen. Un magazine est une publication plurielle, tant par le nombre de ses articles que par celui de leurs auteurs. Chaque Bulletin est constitué d’un essai, sur un seul sujet. Comme pour se singulariser davantage, l’essai n’est jamais signé ni lardé de publicité, et il est distribué gratuitement.
S’il n’est ni un bulletin ordinaire ni un magazine, qu’est-il donc ? Un billet ou un essai tout simplement. Une publication inclassable qui se définit essentiellement par sa vocation : être au service des autres, pour reprendre le titre d’un de ses très anciens numéros. Le but premier du Bulletin est d’aider les gens à comprendre le monde qui les entoure et par là, à mieux comprendre leur propre existence.
Il attaque cet immense problème sur plusieurs fronts. Tantôt il s’efforce d’instruire, comme quand il traite de l’écriture, de la négociation, de l’art oratoire, de la conduite d’une réunion ou des multiples aspects de la gestion. Tantôt il se fait psychologue pour analyser les rapports avec la famille, les collègues, les supérieurs, les subordonnés. De temps à autre, il fait l’apologie d’un passe- temps comme la lecture, le sport, le plein-air.
Le fil conducteur dans ce foisonnement d’idées, c’est la vie en société, plus particulièrement au Canada. Le Bulletin fait grand cas des besoins de notre société dans les domaines de l’enseignement, des affaires et de la science. Il se penche périodiquement sur la culture, la géographie et l’histoire du Canada. Il n’abandonne sa position résolument non partisane que pour défendre l’unité nationale.
Il n’a pas toujours été aussi éclectique. Son ancêtre, le Royal Bank of Canada Monthly Letter qui a été lancé en avril 1920, était une note de conjoncture financière classique à l’intention des clients commerciaux de la Banque Royale. Il était rédigé par Graham F. Towers, un jeune et brillant économiste montréalais. En 1934, le gouvernement canadien en fera le premier gouverneur de sa toute nouvelle banque centrale.
Était-ce l’effet du stage de comptabilité que Towers avait fait antérieurement à la succursale de La Havane ? Toujours est-il que sous sa plume, le Bulletin ressemblait à la correspondance d’un globe-trotter : Towers pouvait disséquer avec autant de brio la réforme monétaire de la Russie post-révolutionnaire que la thésaurisation de l’or en Extrême-Orient. Il fut remplacé par un autre internationaliste convaincu, le docteur en économie D. M. Marvin, qui deviendra par la suite directeur général de l’U.N.R.R.A (Administration des Nations unies pour les secours et la reconstruction en Europe). Les éditeurs suivants, E J. Horning et Mildred Turnbull, s’en tinrent aux classiques commentaires à saveur économico-financière qui caractérisaient alors les publications des banques canadiennes et britanniques, sans chercher à s’en démarquer outre mesure.
| Brève anthologie du Bulletin de la Banque RoyaleDepuis un demi-siècle, le Bulletin aborde tous les sujets possibles avec une finesse de style saluée par des générations de lecteurs. Nous vous présentons ci-dessous quelques exemples choisis au hasard de ces commentaires aussi frappants par la forme que par le fond.SUR L’ERREURQuel est l’homme qui n’a jamais commis d’erreur dans sa vie. Ceux qui ne se trompent jamais sont les morts, comme les momies embaumées depuis quatre ou cinq mille ans.
|
| janvier 1952 |
e principal anniversaire que nous célébrons ici est l’oeuvre de John Heron. Il y a exactement 50 ans et un mois, ce journaliste chevronné, qui avait été engagé par la Banque en 1940 comme conseiller en relations publiques, devenait le rédacteur du Bulletin et le transformait en publication d’intérêt général. La vie de cet homme remarquable est résumée à la page 5.
Lorsque Sydney Dobson, alors directeur général de la Banque, lui avait offert le poste, il s’était récrié : « Je ne pourrai jamais ! » Il n’était ni banquier ni économiste, après tout. Mais peu après, il faisait la contre-proposition suivante à Dobson. La Banque Royale cultivait depuis longtemps l’image d’une institution engagée dans son milieu et dévouée aux intérêts des simples citoyens, des petites gens qui formaient le gros de sa clientèle. Pourquoi ne pas utiliser le Bulletin pour leur prouver que « la Banque s’intéresse à autre chose qu’à l’argent » ? Heron proposait en somme de le mettre au service de toute la société.
Dobson devait lui-même trancher assez radicalement sur ces modèles de conservatisme qu’étaient les banquiers canadiens de l’époque puisqu’il accepta la proposition. Le premier Bulletin d’intérêt général parut en décembre 1943. Son sujet : l’Inde. Il plut tellement au service d’information du gouvernement britannique qu’il le fit tirer sous forme de brochure et le distribua dans tout le Commonwealth.
Au fil des ans, Heron ouvrit les pages du Bulletin à des sujets comme l’aide sociale, la jeunesse et la médecine. Beaucoup de ses choix se sont révélés prémonitoires. Dès 1946, il consacrait un essai à la situation des femmes, et l’un de ses billets de 1947 traitait des droits des peuples autochtones du Canada. Longtemps avant que l’écologie ne fasse les manchettes, le Bulletin plaidait en faveur de la protection des forêts, de la préservation des terres arables et des économies d’énergie.
L’élargissement des thèmes eut pour corollaire celui de la diffusion. Le Bulletin ne faisait – ne fait encore – l’objet d’aucune publicité ou promotion, mais les demandes d’abonnement affluèrent pourtant de tous les coins du Canada et du monde. Il n’était pas nécessaire de faire affaire avec la Banque Royale pour inscrire son nom sur la liste d’envoi, et le nombre des exemplaires postés aux lecteurs qui n’étaient pas des clients dépassa vite de beaucoup le volume de la distribution en succursale. Entre 1943 et 1950, le nombre des lecteurs grimpa de 10 000 à 150 000, surtout à cause des abonnements suscités par la rumeur publique. Les patrons de Heron étaient conscients du phénomène que représentait le Bulletin dans le milieu peu suspect de sentimentalisme qui était le leur. Grâce à ce billet mensuel, la Banque Royale nouait un rapport direct et chaleureux avec une véritable légion de clients acquis ou potentiels; les milliers de lettres d’éloges qu’elle recevait chaque année en étaient la plus belle preuve. Le Bulletin lui permettait de se démarquer des autres institutions financières, d’insuffler une chaleur toute humaine à l’image austère, pétrie de pragmatisme, de sa confrérie. « Personne ne peut nier que ce Bulletin mensuel soit un excellent outil de relations publiques », devait reconnaître le directeur général James Muir lors de l’assemblée générale de 1948.
Il finit par devenir une véritable institution nationale, au point que dans les années cinquante, C.D. Howe, l’homme fort du gouvernement, put réduire au silence un député de l’opposition qui prétendait en lire un extrait à la Chambre en grommelant : « Nous l’avons tous lu ! » Sa réputation n’était pas moins grande dans les cercles politiques américains. En 1979, Edmund Muskie, le sénateur qui allait bientôt devenir secrétaire d’Etat, fit consigner un essai intitulé God Bless Americans au procès-verbal du Congrès. Le Bulletin a d’ailleurs de nombreux admirateurs aux États- Unis : notre liste d’envoi comporte actuellement quelque 23 000 adresses américaines.
On ne compte plus les réimpressions du Bulletin à l’échelle mondiale. Certains ont paru dans des petits magazines destinés aux éleveurs de canaris ou aux admirateurs de Sherlock Holmes, d’autres dans des revues à grand tirage comme Business Week ou Sélection du Reader’s Digest. Nos essais figurent également dans bon nombre de manuels et d’anthologies de littérature canadienne. La palme du repiquage va toutefois au Bulletin interne de la Banque de Montréal qui a encarté 11 000 copies du nôtre intitulé « Pour devenir un chef » dans une de ses livraisons de 1952 ! Notre rivale n’est que l’une des innombrables entreprises de la planète qui ont eu recours à nos services pour communiquer avec leur personnel. Le Bulletin a été exploité tout aussi largement dans le monde de l’enseignement.
Le plagiat étant la plus sincère des flatteries, nous avons été très honorés d’apprendre qu’un journal vénézuélien avait publié un de nos textes sur l’histoire du Canada – sans mentionner sa source. L’incident, qui remonte à 1979, met en relief le prestige du Bulletin hors de nos frontières. Les missions diplomatiques du Canada y ont fréquemment eu recours pour faire connaître notre pays. Une dizaine de milliers de personnes y sont abonnées dans plus de 75 pays étrangers.
Les traductions publiées vont du japonais à l’allemand en passant par l’espagnol, le portugais, le turc, l’hindi, le danois, le finnois, l’italien, l’hébreu et le néerlandais, sans parler de l’excellente adaptation française que nous distribuons à 50 000 exemplaires. Le Bulletin est aussi enregistré sur cassette en version anglaise et française pour ceux qui ont peine à lire. En 1977, l’Institute for Lederskab øg Lonsomhed a publié un recueil de nos essais en norvégien. Le Business Education Institute de Melbourne l’a imité en 1982. Intitulée A Vision Splendid, sa collection comporte une postface rédigée par M. Roly Leopold, président de l’institut : « Par leur sagesse, leur richesse, leurs valeurs éternelles, y affirme-t-il, ces lettres sont d’un grand secours, non seulement pour ceux qui les lisent, mais aussi pour leurs familles, leurs amis, leurs collègues et tous ceux qu’ils influencent. »
|
Sur l’éducationImputer aux professeurs les maux du système d’éducation moderne revient tout simplement à condamner le messager porteur de mauvaises nouvelles. Les enseignants n’ont pas inventé le système, ni ne sont les responsables de la gestion d’une machine façonnée au gré des politiques et administrée par des bureaucrates-pédagogues qu’ils considèrent souvent comme des ennemis invétérés. Si le public, par l’entremise de délégués élus et nommés, opte pour le nivelage éducatif qui rend l’échec impossible, ou des programmes si peu exigeants que les journées scolaires sont des invitations à la flânerie, la faute n’en est pas au corps enseignant. Si les parents sont négligents au point de ne pas remarquer que Pierrot, à son âge, ne sait pas lire, ont-ils vraiment le droit de protester
septembre/octobre 1989
|
Les éloges de ce genre sont monnaie courante dans les milliers de lettres qui nous parviennent d’endroits aussi éloignés que le Yukon et le Nigeria, de lieux aussi différents qu’une prison, un couvent ou un navire en haute mer. Ils démontrent – à notre humble avis – que le Bulletin de la Banque Royale est l’une des publications les plus aimées du monde. Cela s’explique entre autres par son ton volontairement optimiste, une rareté à notre époque.
Dans une entrevue qu’il a donnée en 1968, John Heron l’a expliqué ainsi : « C’est si facile de démolir que beaucoup d’écrivains se laissent prendre au piège. Ils font comme ce dictateur romain qui se promenait dans son jardin armé d’un gourdin avec lequel il abattait les plus grandes et les plus belles fleurs. Ils trouvent plus simple et plus rentable d’abaisser ce qui est grand, de saper l’ordre établi, d’aggraver la confusion. »
La référence à la Rome antique illustre à la perfection la démarche de l’écrivain décédé. Heron puisait dans la sagesse ancienne les lumières qui lui servaient à dissiper les ombres de la vie contemporaine. Il usait abondamment de citations de toutes les époques. Il disait des philosophes qu’il affectionnait : « Ils ont analysé des relations humaines fondamentales qui sont universelles. Ce qu’ils ont écrit là-dessus a résisté au temps et ne pourrait être mieux dit. »
Bien qu’il ait dû être l’auteur canadien le plus lu de son temps – au milieu des années soixante, son essai mensuel était tiré à plus de 650 000 exemplaires – Heron a toujours tenu à rester anonyme. Le Bulletin, soutenait-il, est un pont entre la Banque et ses lecteurs; son auteur ne doit pas faire écran. « Tel qu’il est, il jouit de tout le prestige de la plus grande banque du Canada; signé, il n’aurait que le nom d’un écrivain obscur. » Il faut dire aussi que le Bulletin a toujours eu une composante collective : les cadres supérieurs contrôlent la conformité de chaque thème et texte aux politiques de la Banque et suggèrent souvent des modifications propres à compléter ou clarifier le propos.
John Heron a rédigé son 307e et dernier Bulletin mensuel à la fin de 1975, à l’âge de 79 ans. Pendant deux ans après sa retraite, la Banque a publié d’anciens textes tout en s’interrogeant sur l’avenir de la formule. La hausse des frais de poste et de production en faisait désormais un luxe si coûteux qu’il aurait été justifié d’y mettre fin en prenant prétexte du fait que son rédacteur était irremplaçable et son style plutôt victorien, mésadapté au goût moderne. Mais il procurait toujours à la Banque une notoriété exceptionnelle qui favorisait ses affaires à l’étranger et témoignait de son civisme.
On finit par décider de poursuivre à plus petite échelle, en retenant les services d’un rédacteur à temps partiel. L’élu fut – est – Robert Stewart, journaliste et écrivain chevronné dont l’oeuvre couvre à peu près tous les domaines de l’activité humaine, de la macroéconomie à la poésie contemporaine (voir sa notice biographique, page 5). Le premier Bulletin issu de sa plume parut en janvier 1978, sans signature comme d’habitude, mais avec une présentation graphique plus conforme au style du nouveau rédacteur.
Les thèmes privilégiés par Stewart touchent d’encore plus près à la vie quotidienne. L’analyse des sentiments y occupe une grande place : la fierté, la motivation, l’enthousiasme, le vieillissement… Les biographies de Canadiens illustres sont une autre de ses spécialités. Il a aussi traité de l’évolution des mentalités à propos des handicaps, de l’analphabétisme, des maladies mentales, de la mort, de l’autonomie individuelle. S’il a modernisé le ton du Bulletin, il n’a pas abjuré les valeurs intemporelles qu’il défendait et les prône toujours avec vigueur, citations à l’appui. Parmi les textes qui lui ont valu le plus d’éloges ces dernières années, figurent des essais sur des qualités apparemment abolies par l’agitation de la vie moderne : le respect, la politesse, le caractère, le sens des responsabilités, la courtoisie. Au début de la dernière décennie, une vague de compressions budgétaires a transformé le billet mensuel en publication bimestrielle et a réduit sa liste d’envoi aux abonnés qui avaient manifesté clairement et récemment leur intérêt. En 1983, le tirage était tombé à 100 000 exemplaires. Les demandes d’abonnement affluaient encore en si grand nombre, cependant, qu’il n’a cessé d’augmenter depuis. La Banque en distribue actuellement 230 000 copies, dont 197 000 au Canada.
Ce qui illustre peut-être le mieux la place que le Bulletin tient dans le coeur de ses lecteurs, c’est le poème que l’écrivain montréalais Stuart Richardson a écrit en son honneur. Combien d’autres périodiques pourraient en dire autant ? Publié dans l’édition du 7 mars 1985 du Town of Mount Royal Weekly Post, il occupait la plus grande partie d’une page. L’espace nous manque pour le reproduire intégralement, mais son avant-dernière strophe résume avec finesse l’esprit qui a guidé la Banque Royale dans cette entreprise :
Le Bulletin de la Banque RoyaleNe sert pas les intérêts de cette banque,Mais bien ceux d’un CanadaDigne de notre espérance.Ce Bulletin de chaque moisEst bon, et clair, et franc.Il parle de tout et de n’importe quoiMais jamais de la Banque.
Au coeur de l’actualité pendant cinq décennies
Bien qu’il fasse fréquemment appel à l’histoire et à la pensée antiques pour jeter un peu de lumière sur les événements et attitudes d’aujourd’hui, le Bulletin a toujours livré une critique alerte et perspicace de la modernité depuis qu’il s’est converti en observatoire de la vie contemporaine, il y a un demi- siècle. À preuve, ces extraits d’un certain nombre d’essais consacrés à des problèmes d’une brûlante actualité à l’époque où ils ont paru.
|
Dans le climat effervescent de l’après-guerre, rien ne paraît impossible à la science. Le Bulletin voit les choses de plus haut…
|
Le rôle de la science dans la vie – janvier 1949
Si la diplomatie peut faire profiter les gens ordinaires de tous les avantages offerts par la science, elle peut leur procurer des pouvoirs nouveaux et inconnus jusqu’ici de satisfaction personnelle… Voilà ce qu’il nous reste à faire malgré tous nos progrès. À part la conquête de l’espace, dont on parle tant aujourd’hui, et celle des maladies, il y a la question essentielle de vivre ensemble.
Nos progrès dans certaines voies sont indiqués par l’action d’un délégué aux Nations Unies à Lake Success l’an dernier qui demanda par câble à son gouvernement la permission de soulever la question des droits de souveraineté sur la lune. Et pourtant, les peuples de la terre sont incapables de régler leurs propres frontières nationales, et l’ambition d’un seul gouvernement tyrannique met trois continents en tumulte.
La science nous a placés sur une éminence d’où nous pouvons voir très loin, mais nous ne savons pas ce qu’il y a au-dessous de l’horizon. Le plus grand problème de tous est celui qui est juste à nos pieds : comment nous comporter socialement de façon que la science puisse faire son possible pour rendre l’existence plus heureuse, plus facile, et plus satisfaisante.
|
Sur la libertéLa liberté démocratique a sombré dans certains pays parce que leurs peuples sommeillaient. On entend souvent les gens qui ont combattu contre nous dans les dernières guerres alléguer deux raisons comme excuses : ils ne se rendaient pas compte de ce qui arrivait à leur gouvernement et ils ne pouvaient qu’obéir aux ordres. En vérité, la tyrannie dégrade à la fois ceux qui l’exercent et ceux qui la souffrent.
décembre 1957
|
|
Les années cinquante sont marquées par la peur de l’anéantissement nucléaire et une quête éperdue de sécurité…
|
Citoyens du monde entier – avril 1950
Il a fallu longtemps pour forger les premiers outils de pierre, et les Nations Unies, qui sont un outil de paix, sont depuis peu de temps à l’oeuvre. Elles font un bon travail, mais leur rôle ne sera réellement efficace que lorsque quelque événement imprévu en aura fait comprendre au monde entier la nécessité et la valeur.
Peut-être que dans ce cas, comme en toutes choses, ce sont les petits qui devraient mettre la machine en train. Si un assez grand nombre de particuliers répétaient sans cesse aux représentants des Nations Unies : « Dépêchez-vous de vous unir », peut-être que cela aiderait.
Peut-être également faudrait-il déployer en lettres de feu dans chaque ville et village, sur toutes les tribunes législatives et sur tous les pupitres des instituteurs la première phrase de la Charte : Nous, peuples des Nations Unies, sommes résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre.
|
Sur le fosséEntre les générationsOn a dit que la plus grande erreur de la génération actuelle – de toute génération actuelle – était de ne pas lire le procès-verbal de la dernière séance. Elle a ainsi dès le départ le désavantage d’avoir à apprendre à son tour par la pratique ce qu’elle n’aurait eu qu’à lire dans l’histoire de ses ancêtres.
avril 1956
|
|
Au cours des années soixante, les jeunes prennent la société d’assaut, critiquant sans merci les valeurs chères à leurs parents, bousculant l’ordre politique à coup de manifestations…
|
Être jeune en 1969… – avril 1969
Ce qu’il importe absolument de reconnaître, c’est qu’il s’est produit un profond et vaste changement d’attitude chez les jeunes gens. La pire erreur est d’y être indifférent.
Mais il ne faut pas pour autant être trop indulgent. Les adultes peuvent toujours contester la confiance naïve de certains jeunes dans leur théorie de la décentralisation du pouvoir de décision, signaler que l’excentricité des vêtements et l’impolitesse des manières ne sont pas des preuves d’indépendance, que s’emballer éperdument pour une cause lointaine, éphémère et sans importance n’est pas un signe de maturité.
Mais les adultes doivent admettre d’autre part qu’ils ont quelque peu négligé leur devoir de se maintenir à la page; qu’ils n’ont pas réussi à prêcher d’exemple; qu’ils ont fait preuve de faiblesse en contribuant à rendre la vie trop facile et la discipline trop lâche. Chaque groupe a des habitudes et des idées qui ont besoin d’être conciliées, et cette conciliation est possible par le dialogue.
|
Sur la loiLes prescriptions de la loi demeurent notre seule ancre sur une mer houleuse. Vivre honorablement, ne léser personne, rendre à chacun son dû, c’est là une règle de vie qui permet aux hommes de coexister, sinon dans l’entraide, du moins dans la tolérance mutuelle et la liberté de vivre à l’abri de la crainte.La seule base solide sur laquelle puisse s’édifier un avenir brillant est la collaboration de tous les citoyens à la ferme application de la loi. Il n’y a pas de moyen terme. La répugnance à se compromettre ou la simple apathie rangent le citoyen du côté du crime et contre l’ordre public aussi sûrement que s’il fournissait une auto aux malfaiteurs pour fuir le lieu du crime.
Mars 1969
|
|
Sur la peurIl n’est pas possible que les hommes soient un jour affranchis de toute peur ni qu’ils veuillent l’être. Sans son instinctive sonnette d’alarme, ils seraient impuissants à conjurer le danger. La peur est donc l’allié de l’homme… mais c’est tout au plus un allié sujet à caution. Il est retors et ambitieux, guettant sans cesse l’occasion de s’emparer de nous. Il faut le surveiller de près si l’on veut le tenir à distance et en tirer profit.
Décembre 1978
|
|
Révélation des années soixante-dix, l’« écologie » bouleverse l’opinion en dénonçant le pillage des ressources de la planète dans l’insouciance la plus complète du lendemain…
|
À la découverte de la nature – juillet 1978
Il n’est guère à l’honneur de l’ordre des priorités établi par notre société qu’un écolier puisse dire la marque de toutes les automobiles qui passent, mais ne soit capable d’identifier que les arbres et les fleurs sauvages les plus connus. La raison, c’est que de façon générale le système d’enseignement de l’Amérique du Nord est si confiné aux quatre murs des classes que les jeunes intelligences y suffoquent. Peu d’écoles savent profiter du grand livre de la nature pour enseigner les choses qui importent vraiment : les principes de la vie sur une planète menacée. Les enfants étudient les larves et les têtards dans des gobelets de carton, à l’intérieur des classes, au lieu d’étoffer leurs connaissances en examinant le milieu complexe où vivent en réalité ces êtres.
C’est malheureux, car l’enfant est normalement l’observateur le plus curieux de la nature. Tous les parents savent combien les petits enfants aiment apporter des chenilles, des sauterelles, des grenouilles à la maison. Mais ils encouragent rarement ce goût instinctif en initiant leurs enfants à la connaissance de la nature. Il arrive trop souvent que les aînés détournent l’intérêt des enfants pour le monde naturel par leur insistance sur la valeur des objets inanimés que procure l’argent.
C’est aujourd’hui une question évidente de survie pour l’homme que d’apprendre à connaître les limites de son rôle dans le monde.
|
Sur la médiocritéLes vedettes créées du jour au lendemain dans le monde du spectacle donnent l’impression qu’il n’est pas nécessaire de savoir chanter ou jouer d’un instrument quelconque pour accéder à la renommée et faire de l’argent. Bien des succès de librairie ont tout l’air d’avoir été écrits non pas sur, mais par des ordinateurs tant les intrigues sont banales et le vocabulaire approximatif. Bâclées, les « comédies » télévisées n’ont plus de comique que l’intention. Et l’on se demande devant tant de médiocrité si la société n’a pas perdu tout sens des valeurs.
Novembre/Décembre
|
|
Sur la négociationLa négociation, spécifiquement humaine, permet de régler les différends en limitant les querelles au minimum. Les animaux, eux, doivent soit se battre, soit fuir, en cas de conflit. Notre habileté à échanger des idées nous offre une autre solution. C’est ainsi que les individus les plus chétifs de l’espèce humaine peuvent faire valoir leurs droits avec autant de force que les plus robustes.
Juillet/Août 1986
|
|
En Occident, la huitième décennie du siècle appartient au « moi ». Toutes les indulgences, les prétentions, les exigences se justifient en son nom. Même quand elles lèsent gravement la communauté…
|
La force de caractère – mai/juin 1988
S’il est vrai que la culture populaire reflète les mentalités d’une époque, les tendances actuelles que laissent transparaître les livres, les films et les émissions télévisées donnent à réfléchir. Le manque de maîtrise de soi des anti-héros et anti-héroïnes qui jouent des scènes empruntées à la vie de la fin du 20e siècle est évident. Qu’il s’agisse d’argent, de pouvoir ou de passion, ils parviennent à leurs fins sans s’encombrer de scrupules; leur sens de la justice ne leur pose aucun cas de conscience. « Si vous voulez comprendre ce qu’est la vertu, observez la conduite des hommes vertueux » recommandait Aristote. Comment suivre un tel conseil si les seuls modèles du comportement humain sont ceux fournis par le monde des spectacles !
Les romans de l’époque post-victorienne enseignaient aux jeunes que la route du succès était pavée de diligence, d’honnêteté et d’intégrité. La leçon que leur donne aujourd’hui la télévision serait plutôt que l’argent peut faire le bonheur et que pour l’obtenir il n’y a pas lieu de se laisser étouffer par ses scrupules.
|
Sur l’innovationSir Alexander Fleming n’a pas, comme voudrait nous le faire croire la légende, simplement jeté un coup d’oeil à la moisissure qui couvrait un morceau de fromage pour avoir sur-le-champ la révélation de l’existence de la pénicilline. Il travailla avec des substances anti- bactériennes pendant neuf ans, avant de parvenir à sa découverte. Les inventions et les innovations sont presque toujours le fruit d’expériences laborieuses. L’innovation est semblable au hockey : même les meilleurs joueurs manquent le filet et voient leurs tirs bloqués plus souvent qu’ils ne marquent.
Mars/Avril 1988
|
|
À dix années de l’an 2000, le problème de l’égalité des sexes prend une coloration nouvelle…
|
Tiré de l’article « Le monde du travail se civilise » – mars/ avril 1992
L’époque ou une mère veuve, séparée ou divorcée était reléguée à vie dans un poste subalterne est depuis longtemps révolue. Aujourd’hui elle est mariée, ou pas, cadre ou spécialiste, dotée de compétences et d’une formation qui la rendent précieuse aux yeux de son entreprise. Elle n’abandonnera que temporairement son travail pour avoir des enfants, lorsqu’elle aura la trentaine, voire la quarantaine. Aucune raison, pour elle, de choisir entre sa famille et sa carrière; elle juge pouvoir se consacrer aux deux sous réserve que son travail ne nuise en rien au bien-être de ses enfants. Une nouvelle race de travailleurs masculins est également en train de naître. L’homme fait souvent partie d’un couple qui jouit d’un double revenu; il partage les tâches ménagères avec sa femme, ou du moins en assume une partie. Comme l’ont révélé de nombreux sondages, il est souvent tiraillé entre son travail et les soins à donner à ses enfants ou à ses vieux parents.
Toutes les recherches semblent donc indiquer qu’une évolution des attitudes, des gestionnaires et des employés des deux sexes, s’impose. Les gestionnaires doivent prendre conscience que des conditions de travail particulières n’encouragent pas la paresse ni ne sont incompatibles avec une carrière. Les gestionnaires trouvent difficile d’abandonner les anciennes prérogatives des employeurs, notamment les prescriptions des lieux et des heures de travail des employés.
« La civilisation consiste à multiplier et à affiner les besoins humains », a écrit Robert A. Millikan, scientifique américain. Ces besoins ne touchent pas tous aux choses matérielles. Le plus profond d’entre eux relève du monde des sentiments. Les nouveaux régimes que les entreprises éclairées élaborent pour s’adapter à l’évolution de la main-d’oeuvre s’adressent directement aux sentiments profonds qui existent au sein des familles unies. En parlant de son héros Sigmund Freud, le psychanalyste Theodore Reik a observé que « dans le cadre d’un traitement psychanalytique, ses objectifs se limitaient à amener le patient au point où il était capable de travailler pour vivre, et d’aimer : le travail et l’amour, les deux pôles de la vie. » Les entreprises qui modifient les conditions de travail pour accommoder les obligations personnelles de leurs employés s’ingénient essentiellement à concilier les impératifs du travail et ceux de l’amour familial.
Les auteurs du Bulletin
À un lecteur qui voulait savoir combien de temps il avait consacré à un récent Bulletin mensuel, John Heron a déjà répondu : « J’y réfléchis depuis la fin de la Première Guerre mondiale. » C’est arrivé… pendant les années soixante.
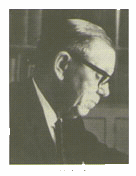
L’écrivain qui a métamorphosé une aride note de conjoncture économique en publication aimée et admirée dans le monde entier, était avant tout un penseur. Ses anciens collègues conservent le souvenir ému de sa silhouette solitaire, attablée devant un repas qui refroidit tandis que s’empilent sur la nappe les fiches beiges qu’il traîne toujours sur lui pour noter au vol les idées qui lui traversent l’esprit.
Apprendre fut la grande passion de son existence, peut-être parce qu’il avait interrompu ses études à 18 ans pour s’enrôler dans l’armée canadienne. Il venait d’arriver au Canada, ayant quitté l’Irlande du Nord avec ses parents à peine un an plus tôt. Il sera blessé à deux reprises sur les terribles champs de bataille de France et de Belgique.
En 1919, il devient le directeur du pensionnat de garçons de la réserve Peigan, en Alberta. Dans les loisirs que lui laissent la supervision des travaux des champs et l’enseignement des métiers d’art, il fait le compte rendu des événements sportifs qui ont lieu à l’école pour les journaux de la province.
Cette expérience lui vaut un poste de journaliste au Toronto Daily Star et au Star Weekly, son magazine hebdomadaire. Les cours d’écriture qu’il donne aux jeunes reporters pendant sa période torontoise témoignent déjà du vif intérêt pour le mot imprimé qu’il manifestera dans la remarquable série de Lettres mensuelles dont a été tiré son ouvrage La transmission des idées.
En 1940, il déménage à Montréal, où l’attend un poste de conseiller en relations publiques à la Banque Royale. Le conseil le plus précieux qu’il donnera à ses nouveaux patrons sera de transformer le Bulletin en publication d’intérêt général et de lui en confier la rédaction.
Cet homme discret ne s’accordait aucun crédit dans le rayonnement international du Bulletin, prétendant qu’il ne faisait que donner une voix à la conscience sociale de la Banque. S’il a beaucoup écrit sur des causes généreuses comme l’éducation des adultes et l’engagement communautaire, il a aussi prêché par l’exemple au sein de plusieurs groupes de citoyens. Ses nombreux essais sur les jeunes s’appuyaient sur l’expérience acquise au conseil d’administration d’un Montreal’s Boys’ Club. Ses textes sur les valeurs familiales reflétaient sa vie privée : ce père de quatre enfants vouait un culte à la famille.
John Heron a pris sa retraite en 1976, au terme de 32 années de brillants services littéraires. Il avait 79 ans. Il est mort en 1983. Le perfectionnisme, la soif de progrès et l’idéalisme qui ont guidé sa vie sont à l’image des billets qui ont réconforté ses centaines de milliers de lecteurs. Il a donné à ceux qui l’ont connu le plus bel exemple du dépassement personnel qu’il prônait dans l’un des essais les plus admirés qu’il ait produit : Le culte de la supériorité.
L’homme qui rédige et édite le Bulletin de la Banque Royale depuis 16 ans a fait ses premières armes de journaliste d’une façon très « canadienne », en couvrant les parties de hockey qui avaient lieu dans une patinoire non chauffée de sa région, le nord de l’Ontario. Le jeune Robert Stewart y acquerra l’amour du pays qui imprègne tous ses écrits.
Les admirateurs du Bulletin vantent souvent son « ton » caractéristique, qu’ils qualifient de « raisonnable, ouvert, modéré, sans prétention ». S’ils ont raison, répond Stewart, « ma nationalité n’y est sans doute pas pour rien. Les Canadiens ont la réputation méritée de comprendre le point de vue de l’autre et de détester les extrêmes et la vantardise. »
Son patriotisme n’est jamais chauvin, cependant. Ce pigiste chevronné a souvent travaillé à l’étranger, pour des entreprises de presse aussi prestigieuses que le Wall Street Journal, le Time et le service d’information du Dow-Jones. Le livre sur le Labrador qu’il a publié chez Time-Life International en 1977 a été traduit en plusieurs langues. Un autre ouvrage paru en 1979, Sam Steele : Lion of the Frontier, témoigne de son intérêt pour l’histoire canadienne.
Grand voyageur, Stewart trouve à l’étranger « la distance qui me permet de mettre les choses en perspective dans le Bulletin ». En revanche, il mène le gros de sa recherche chez lui, dans une bibliothèque – de quelque 2 800 titres – particulièrement riche en biographies et en textes historiques. Un fichier informatique de près de 5 000 citations lui permet d’étayer tout ce qu’il avance d’une phrase bien choisie.
Aujourd’hui âgé de 55 ans, Stewart doit sa polyvalence à une expérience professionnelle d’une rare diversité. Il a été tour à tour reporter judiciaire, critique de théâtre et de littérature, chroniqueur de voyages et de plein-air, correspondant à Ottawa et rédacteur en chef du Financial Times of Canada.
Pour écrire le Bulletin, il a dû ajouter à cet impressionnant bagage des lectures en philosophie et en logique. « Comme j’essaie de remonter aux sources de mon sujet, je suis souvent forcé de faire appel aux philosophes grecs ou romains de l’Antiquité, explique-t-il. Je ne néglige pas pour autant les époques ultérieures, et je cite volontiers des sources modernes. »
Son goût pour la logique naît du désir de mieux armer ses lecteurs contre la propagande voilée qu’il observe un peu partout. Il estime essentiel de les alerter sur les pièges de l’information et de dénoncer les failles des thèses politiques et sociales du jour.
« Comme Hannah More, je crois que les gens ont moins besoin d’instructions que de rappels, dit-il, et je suis là pour leur rappeler que les progrès très réels de l’humanité sont souvent obscurcis par la fumée des controverses et des conflits. »
Si le Bulletin de la Banque Royale réussit à dissiper une partie de cette fumée, conclut-il, il aura enrichi ses lecteurs.

