Entrevu par l’étroite lucarne du vingtième siècle, l’avenir de notre espèce paraît terriblement compromis. Contemplé au travers de l’immense baie du millénaire, il s’annonce au contraire comme une longue ascension vers un sommet aux contours encore inimaginables.
À la fin du dernier millénaire, deux écoles de pensée se partageaient la frange instruite de la population européenne. La première annonçait le retour imminent du Christ et l’avènement concomitant de mille années de bonheur universel; l’autre prophétisait rien de moins que la fin du monde dès la première seconde du premier jour de l’An 1000.
Nous en sommes toujours là, à quelques variations chronologiques et programmatiques près. En dignes héritiers des clercs médiévaux, nos futurologues se partagent eux aussi en deux camps irréconciliables : d’un côté, ceux qui anticipent une ascension vers de nouveaux sommets de confort matériel; de l’autre, ceux qui prévoient l’effondrement de la civilisation.
À première vue, la thèse des seconds semble plus plausible. Ensemble ou séparément, les menaces qui pèsent sur l’humanité – famine mondiale, désastre écologique, pandémies, dérèglement du climat, guerre nucléaire ou biologique – devraient empêcher notre espèce de survivre mille ans, ou même seulement cinq cents.
De tous les risques que nous courons, la surpopulation est sans aucun doute le plus grave. Le nombre des bouches à nourrir s’accroît à un rythme prodigieux : en un demi-siècle, il est passé de deux milliards sept cent cinquante millions à cinq milliards. Si rien ne change, il doublera encore d’ici 50 ans.
Or, les pays accablés par cette explosion démographique sont en proie à une misère si effroyable que la faim y fait déjà des ravages. Quelque 800 millions d’êtres humains, plus de 25 fois la population du Canada, croupissent dans ce que les experts de l’ONU dénomment « pauvreté absolue », condamnés à la malnutrition chronique. Trois milliards vivent dans une « pauvreté relative » qui leur assure logement et nourriture, mais ne leur laisse pas de quoi se vêtir convenablement, se soigner ou s’instruire.
Cette croissance débridée met à l’épreuve bien plus que la capacité de la Terre à nourrir ses habitants. Pour tenter d’endiguer cette misère, les pays du Tiers Monde s’industrialisent à marches forcées, sans souci des dégâts potentiellement mortels qu’ils infligent à l’environnement. Leurs vastes forêts, précieux poumons de notre planète, sont rasées pour fournir du bois de chauffage et des terres aux paysans. Pendant ce temps, les zones agricoles les plus fertiles, surexploitées, se transforment en déserts.
Cette quête désespérée d’espace et de ressources risque fort de déboucher sur d’atroces guerres intestines ou extérieures qui jetteront sur les routes des légions de réfugiés. Devant un tableau aussi sinistre, on se demande comment qui que ce soit peut entretenir quelque espoir pour le siècle, et plus encore, pour le millénaire approchant.
L’espoir est permis, pourtant, car s’il est une chose que nous enseigne l’histoire du second millénaire de notre ère, c’est que le progrès est têtu. Il poursuivra sa route, soyez-en sûrs. Il avancera même beaucoup plus vite qu’avant, car les ressources à sa disposition, au premier chef l’intelligence humaine, seront plus abondantes que jamais.
Les prédictions apocalyptiques prennent presque toutes comme point de départ la fin du vingtième siècle. Première civilisation de l’histoire à être en communication instantanée avec le monde entier, notre société est devenue incroyablement impressionnable; les médias en font leurs choux gras, sonnant le tocsin au moindre prétexte. Il faut croire que nous aimons nous faire peur. Et l’auto- annihilation de la race humaine est évidemment la meilleure histoire d’horreur qui se puisse inventer.
Nous sommes soumis à un tel barrage d’information que nous ne prêtons attention qu’à ce qui est nouveau ou sensationnel. Et cela nous porte à exagérer l’importance des tendances actuelles dans le grand mouvement de l’histoire.
Ce « chronocentrisme » (pardonnez le néologisme) amène d’éminents universitaires à parler sans rire du « pré-vingtième siècle » comme s’il s’agissait de la préhistoire – comme si tout ce qui s’était passé depuis 3 000 ans n’était qu’un vague prélude à la glorieuse histoire de notre temps. Seul un enfant de cette époque narcissique pouvait intituler un livre La fin de l’histoire, comme l’a fait Francis Fukuyama en 1989, avec un spectaculaire succès de librairie, d’ailleurs.
Durant ces milles années, s’il est une leçon à en tirer, c’est que les capacités de notre espèce se sont accrues de manière exponentielle.
Le progrès engendre le progrès
À vrai dire, les hérauts de « l’Apocalypse demain » ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils présument que les tendances actuelles dureront éternellement : que le moteur à explosion restera roi et maître de la route, polluant l’air et épuisant les réserves de pétrole; que les nappes phréatiques et zones humides de toute la planète seront pompées jusqu’à ce qu’il n’y ait plus une goutte d’eau à en tirer; que les cheminées d’usine continueront à vomir leurs fumées toxiques, élargissant à l’infini le trou dans la couche d’ozone; bref, que l’humanité ne fera rien ou presque pour cesser de salir son nid.
C’est faire fi d’une maxime militaire qui a largement fait ses preuves : prévoir l’imprévisible. Ces problèmes apparemment insolubles pourraient demain être réduits à l’insignifiance par une découverte inopinée, tout comme la variole a été éradiquée grâce au vaccin, elle qui avait fauché tant de millions de vie qu’elle était considérée comme le pire ennemi du genre humain. C’est négliger aussi l’une des principales leçons de l’histoire. Car, enfin, que fait l’homme raisonnable lorsqu’il est prévenu d’un danger ? Il s’efforce de le conjurer ou d’en atténuer les effets.
Nous sommes tellement obnubilés par le présent et le passé récent que nous ne percevons plus les mouvements séculaires. Or, les prévisions qu’ils produisent sont très différentes de celles qu’on obtient en projetant simplement les oscillations du moment. Dans son vaste panorama historique du dernier millénaire (Millenium, Bantam Press, 1995), Felipe Fernandez-Armesto note à juste titre que « les tendances démographiques donnent lieu depuis toujours à des prédictions catastrophiques parce que les profanes qui les interprètent supposent que chaque nouvelle série se prolongera indéfiniment; pourtant, les prévisions basées sur ces tendances ne se sont jamais réalisées qu’à très court terme ». La Terre, conclut-il, saura toujours nourrir ses enfants.
De fait, si on considère le second millénaire de notre ère dans son intégralité, on voit que rien, ni les pestes, ni les famines, ni les guerres mondiales, n’a pu empêcher l’espèce humaine de progresser. C’est que le progrès avance comme une boule de neige dévale une pente : de plus en plus vite à mesure que sa masse augmente. Les générations qui devront résoudre les problèmes du futur disposeront ainsi de toute l’expérience accumulée par leurs prédécesseurs.
Puisqu’il nous est donné de chevaucher deux millénaires, pourquoi ne pas regarder derrière nous aussi bien que devant ? La comparaison ne peut que nous rassurer sur nos chances de triompher des obstacles sur notre route; s’il est une leçon à en tirer, en effet, c’est que les capacités de notre espèce se sont accrues de manière exponentielle durant ces mille années. Les nouveaux hérauts de l’Apocalypse postulent que l’homme ne change pas, n’apprend pas. Or, l’histoire du deuxième millénaire prouve exactement le contraire.
L’avènement de la cité
Pour les besoins de la démonstration, concentrons-nous sur l’Europe occidentale, entre autres parce que c’est la région du monde dont l’histoire est la mieux documentée. La liste des conditions d’existence de sa population il y a mille ans ressemble à une litanie de malédictions : analphabétisme, brigandage, despotisme, épidémies, fanatisme, ignorance, malpropreté, pauvreté, servage, superstition, torture, vermine et bien d’autres encore.
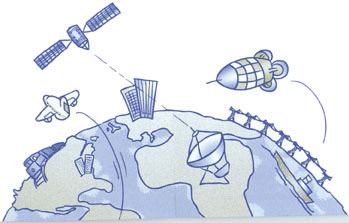
Même dans ces ténèbres, les hommes se montrent capables d’apprendre, et leurs progrès lents mais patients mettront fin à cet âge sombre. S’étant réapproprié la sagesse et le savoir de l’Antiquité en traduisant les oeuvres des philosophes et des savants grecs, romains et arabes, ils recommencent à développer les mathématiques, l’architecture, la musique. Leurs élites échangent idées et observations à l’aide d’un tout nouveau moyen de communication à distance : le papier et la plume.
Le premier grand progrès social du millénaire survient vers la fin du treizième siècle, avec la naissance des villes. Là s’élabore le modèle institutionnel qui fonde la civilisation occidentale contemporaine. Ces proto-municipalités sont en effet gérées par des guildes marchandes et des corporations artisanales; leurs citoyens acquièrent graduellement des droits précis en contrepartie de leurs devoirs civiques. Ces centres urbains deviennent en outre les foyers d’une vie intellectuelle intense, attirant les penseurs et faisant vivre les premières universités.
L’appartenance à la cité engendre au fil des ans une solidarité citoyenne qui inspire la construction d’hôpitaux et d’orphelinats. Ces institutions nouvelles témoignent de l’éclosion d’un sentiment qui sous-tend la philosophie politique de la civilisation : la conviction que le fort doit assistance au faible et qu’il est juste de consacrer une part des richesses collectives à cette fin.
Vers une société plus humaine
De siècle en siècle, la vie quotidienne devient plus supportable pour un nombre croissant de gens. Du quatorzième au dix-huitième siècle, cette volonté de faire mieux nous permet d’inventer quantité de choses si utiles qu’elles nous paraissent aller de soi : les lunettes, l’imprimerie, le plombage dentaire, le billet de banque, le service postal, l’eau courante, l’éclairage public, la machine à coudre, la conserve…
Au dix-huitième siècle, le rythme de ce progrès technique accélère subitement; l’heure du décollage économique a sonné. L’invention de la machine à vapeur marque le grand tournant civilisateur qui libère l’homme de sa dépendance à l’égard des forces de la nature : la traction animale, l’eau, le vent et ses propres muscles.
En parallèle se développe un mouvement intellectuel au nom profondément évocateur : les Lumières. Il fera plus pour l’avancement de l’espèce humaine que toutes les machines à vapeur. C’est lui, en effet, qui formule le discours politique contemporain : tous les hommes naissent égaux (pour les femmes il faudra attendre un peu, hélas !) et doivent donc jouir des mêmes droits. Les idées des philosophes des Lumières font paraître répugnantes des pratiques qui étaient jusque là monnaie courante. Leurs discours sur les droits fondamentaux influencent les monarques les plus éclairés, menant à l’abolition du servage dans plusieurs pays européens et, en 1784, à celle de l’esclavage en France. L’Angleterre imitera l’exemple de sa voisine. Frédéric le Grand, roi de Prusse, décrète même la liberté de la pratique religieuse et de la presse, sapant une tradition bien ancrée d’intolérance qui tolérait très officiellement… la torture et l’exécution des dissidents.
Imaginez si, au cours des dix derniers siècles, les femmes avaient pu entrer en politique comme elles entraient en religion, si elles avaient eu le droit d’aller et d’enseigner à l’université, de faire de la recherche scientifique, d’exercer le métier d’ingénieur; où serions-nous aujourd’hui ?
À partir de ce moment, les progrès deviennent quasiment inévitables. L’élan du dix-huitième siècle se transmet au dix-neuvième, qui l’amplifie au point que découvertes et inventions s’y succèdent à peu près au même rythme que les mois dans l’année. Nombre des « nécessités » de la vie moderne verront le jour bien avant 1900 : l’électricité, les télécommunications, l’automobile, les tissus synthétiques, le cinéma, l’enregistrement sonore, les machines agricoles à haut rendement.
L’humanité déploiera encore des trésors d’ingéniosité durant le vingtième siècle, pas toujours pour la bonne cause, malheureusement : l’armement consumera une part beaucoup trop grande de nos efforts d’imagination. Il n’empêche que nous, citoyens des pays industrialisés, devons nos remarquables conditions de vie aux inventeurs des deux sexes qui se sont engouffrés dans la brèche ouverte par leurs prédécesseurs. Sur le plan historique, l’aspect le plus frappant de ce dernier mouvement, c’est son extension : presque tous les membres des sociétés développées jouissent d’un niveau de confort jadis réservé aux riches parmi les riches.
Les miracles de la croissance
Ce progrès spectaculaire étonne d’autant plus qu’il s’est réalisé sans l’apport d’une bonne moitié de l’humanité. Imaginez qu’au cours des dix derniers siècles, les femmes aient pu entrer en politique comme elles entraient en religion, qu’elles aient eu le droit d’aller et d’enseigner à l’université, de faire de la recherche scientifique, d’exercer le métier d’ingénieur : où serions -nous aujourd’hui ? Et elles n’étaient pas les seules à subir cette exclusion honteuse, fruit de la discrimination et de l’ignorance. Quand on songe à cet immense gaspillage, on se dit que l’espèce humaine est très loin d’avoir donné toute sa mesure.
Chose certaine, si les populations des pays industrialisés jouissent dans l’ensemble d’un niveau de vie correct, c’est grâce à la croissance économique induite par le progrès social et technique. Pourtant, il se trouve des experts, et non des moindres, pour la décrier. En 1972, Potomac Associates, une équipe de recherche affiliée au M.I.T., a publié un livre dont le titre était en soi tout un programme : Halte à la croissance. Sa thèse portait sur la réduction de l’activité économique dans le monde, sinon les limites en seraient atteintes avant cent ans.
Quatre ans plus tard, Herman Kahn et ses collègues de l’institut Hudson, à New York, publiaient The Next 200 Years, une vigoureuse antithèse dans laquelle ils rappelaient que les pays industrialisés avaient tous été sous-développés au sens contemporain du terme, et que c’était justement la croissance qui leur avait apporté l’envergure dont ils jouissaient à présent. Pourquoi devrait-il en être autrement pour les pays en voie de développement ?
S’agissant de l’équation malthusienne population/nourriture, ils posaient le problème en ces termes : les pessimistes font grand cas du fait que les « meilleures terres arables » sont exploitées, mais ils oublient que l’homme a dû les mettre en culture pour qu’elles le deviennent. En réalité, ils ont calculé que la superficie utile de notre planète est au moins quatre fois plus grande que celle qui est effectivement cultivée. Par conséquent, la Terre pourrait nourrir trois fois plus d’êtres humains sans qu’il soit jamais besoin de recourir à des moyens artificiels comme la transformation de produits non comestibles ou la culture hydroponique. Du reste, selon l’équipe de Hudson, le développement freinera la croissance démographique du Tiers Monde comme il a ralenti celle des populations occidentales depuis 150 ans parce que l’amélioration des conditions de vie s’accompagnera d’un relèvement du niveau de scolarité. Selon eux, les femmes en âge de procréer se marieront plus tard si elles passent plus d’années à l’école.
Qui sait si nous n’échangerons pas un jour par radio avec d’autres intelligences ?
Pour le clan des optimistes, l’éducation est la planche de salut de l’humanité. Alvin Toffler, par exemple, observe dans La troisième vague : « Jamais dans l’histoire tant de gens bien préparés n’ont eu accès à une si vaste somme de connaissances de toute nature. » Les applications futures de ce savoir – qui grandit d’heure en heure – apporteront peut-être aux problèmes contemporains des solutions dont nous n’imaginons même pas la forme.

Ce que nous pouvons parfaitement imaginer, en revanche, c’est un monde dans lequel le savoir de l’espèce humaine aurait réglé ou presque bon nombre des problèmes actuels. Puisqu’on a trouvé remède à des maladies qui étaient autrefois mortelles, on devrait parvenir à guérir le cancer. Les recherches en cours dans le domaine de l’énergie peuvent déboucher sur une source inépuisable de carburant propre ou… sur un moteur qui roule sans carburant. Nous avons beaucoup avancé par nos propres moyens, mais qui sait si nous n’échangerons pas un jour par radio avec d’autres intelligences ?
Cela dit, il faut admettre que le progrès technologique ne fera pas notre bonheur si nous devons vivre dans l’oppression et la terreur. Fidèles au principe de l’immuabilité de la nature humaine, les prophètes de malheur nous dépeignent des populations désespérées se livrant pieds et poings liés à des démagogues vite transformés en tyrans. Si le cynique a raison, si l’être humain n’est mû que par la peur, la cupidité, la haine et quelques autres passions inavouables, alors oui, le fort exploitera toujours le faible.
Est-il si sûr, toutefois, que la nature humaine ne puisse changer ? Voyez l’histoire du dernier millénaire. Pour les citoyens des pays développés, la chambre de torture et le navire esclavagiste ne sont plus que les symboles affreux d’un passé si étranger à leur expérience qu’il pourrait appartenir à une civilisation extraterrestre. Et nous avons bien du mal à croire qu’un délit mineur, une fausse signature, ait été puni de mort dans l’Angleterre du dix-neuvième siècle. La cruauté et l’injustice persistent certes dans la société occidentale contemporaine, mais nous avons psychologiquement rompu avec les horreurs de notre passé.
Nous avons inventé la coopération internationale pour tenter de combler au moins partiellement l’écart séparant nos conditions de vie de celles du Tiers Monde. Le problème, c’est que nous représentons seulement le tiers de la population mondiale; la grande masse du genre humain vit encore dans des pays où sévissent l’injustice sociale, la violence, le despotisme et la corruption.
Est-il absurde de lutter pour que les peuples de ces contrées ravagées par la pauvreté, la pollution et les conflits jouissent eux aussi de conditions de vie décentes ? Pas quand on pense à tous les rêves insensés qui sont devenus réalité depuis mille ans. Le monde sera-t-il sauvé ? Et surtout, saurons-nous en faire un lieu de vie plus doux pour tous ceux qui l’habitent ? L’exemple des pays développés autorise à espérer que même la réponse à la deuxième question sera oui.

