Les clubs sociaux ont ce qui manque le plus à notre monde blasé : du coeur. Ils incarnent deux vertus plus que jamais nécessaires, l’idéalisme et le civisme. Honneur à leurs membres !
Les circonstances n’étaient pas de bon augure en 1905. Théâtre des extorsions de la Main noire, des actions de plusieurs groupuscules anarchistes et des machinations de puissants cartels industriels, Chicago avait déjà mauvaise réputation – même si elle n’était pas encore la capitale mondiale du crime – et quiconque y aurait vu quatre hommes en complet sombre se faufiler dans un immeuble déserté pour la nuit aurait automatiquement pensé à une bande de malfaiteurs en train de mijoter un sale coup.
Paul Harris et ses trois compagnons préparaient en effet un mauvais coup… contre ceux qui croient que l’homme est un loup pour l’homme. Car ce qu’ils ont mis en branle le soir du 25 février 1905 dans la pièce 711 du Unity Building, rue Dearborn, c’est un mouvement de progrès socio-économique qui a mobilisé, depuis, des millions de bénévoles aux quatre coins du monde. Qu’ils s’efforcent de protéger les enfants du Tiers Monde contre les maladies ou la cécité, de fournir aux populations déshéritées du matériel et des soins médicaux ou encore, de combattre l’illettrisme, les clubs sociaux qui ont surgi de cette mouvance partagent le même idéal : faire le bien.
Paul Harris ne voit sans doute pas si loin lorsqu’il propose à ses trois amis de se rencontrer régulièrement pour s’épauler, s’encourager et s’instruire les uns les autres. Il veut simplement se retremper dans le climat de camaraderie et d’entraide qui lui manque cruellement depuis qu’il a quitté la petite ville où il a grandi pour exercer comme avocat à Chicago. Séance tenante, les quatre complices décident de fonder un club destiné aux hommes d’affaires et aux membres des professions libérales, et d’organiser ses réunions dans les bureaux de chacun des adhérents à tour de rôle. De ce principe de rotation émerge le nom de la nouvelle association : Rotary Club.
Les adhérents se multiplient, et les rencontres prennent la forme qu’on leur connaît, celle du déjeuner hebdomadaire avec conférencier invité. En 1907, le Rotary innove encore plus radicalement en lançant son premier projet communautaire, la construction de toilettes publiques à l’hôtel de ville de Chicago.
Les clubs de l’époque recrutent de manière très sélective, par affinité religieuse, sportive, professionnelle, politique, etc., et ceux qui font oeuvre charitable réservent en général leurs bienfaits à leurs membres. La règle vaut même pour les associations confessionnelles qui se consacrent aux pauvres et aux malades : celles qui ne travaillent pas exclusivement auprès de leurs coreligionnaires cherchent en réalité à faire des conversions. Les loges franc-maçonnes et autres (Elks, Odd Fellows) prônent certes l’entraide, mais ne l’appliquent pas à l’ensemble de la population (exception faite des Shriners, rejeton plus tardif des francs-maçons qui finance les hôpitaux pour enfants et autres bonnes causes). Les chambres de commerce se veulent au service de la collectivité, mais ne sortent jamais du pré carré commercial. Quant aux fondations charitables, elles ne participent pas directement aux bonnes oeuvres qu’elles financent, alors que les membres des clubs sociaux s’engagent personnellement dans la réalisation des projets du club ou dans la collecte des fonds nécessaires.
|
« Seuls parmi vous seront véritablement heureux ceux qui auront cherché et trouvé le moyen de servir. » Albert Schweitzer
|
Une foi dans le progrès capable de déplacer des montagnes
L’expansion fulgurante du Rotary témoigne éloquemment de l’intérêt que suscite cette nouvelle forme d’engagement social, hors de toute affiliation politique, confessionnelle ou autre. Fondée en 1910, son antenne de Winnipeg est le premier club social canadien. Cinq ans plus tard, la deuxième association du genre naît à Detroit : le club Kiwanis (mot amérindien signifiant « nous nous faisons connaître ») s’installe à Hamilton (Ontario) en 1916. Fait à remarquer, la plupart des clubs dont la dénomination comporte le qualificatif « international » – et ils l’ont presque tous – ont acquis le droit de le porter en s’implantant au Canada.
Le plus grand réseau du monde appartient aujourd’hui à un club fondé en 1917 par Melvin Jones, agent d’assurances et membre du Business Circle de Chicago. Désireux de développer les activités communautaires de son cercle, il convaincra 11 acolytes de former une association baptisée LIONS, acronyme de « Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety » (liberté, intelligence, sécurité nationale ). Lors du congrès de fondation, les distances avec le monde des affaires seront clairement marquées dans une résolution stipulant qu’aucun club n’aura pour objet l’enrichissement de ses membres.
Une publication récente des Lions souligne le caractère surprenant d’une telle position à une époque qui exaltait l’individualisme mercenaire. De fait, ce mouvement d’essence altruiste paraît incongru dans un monde mené d’une main de fer par une poignée de grands capitalistes (lesquels avaient leurs propres clubs, aussi exclusifs que dévoués à leurs intérêts). Mais au fond, pouvait-il naître ailleurs que dans ce Midwest américain du début du siècle, rempli d’une telle foi dans le progrès qu’il se sentait capable de déplacer des montagnes ? Le nom choisi par les fondateurs du club des Optimistes, en 1922, ne s’explique pas autrement.
Bien que la plupart des clubs soient nés dans de grandes cités, c’est dans les petites villes et les banlieues qu’ils ont véritablement pris racine. Ils n’ont guère d’influence sur la marche des affaires dans les mégalopoles contemporaines. Est-ce cette absence qui rend les journalistes urbains et les universitaires si indifférents à leur phénoménale influence sociale ? Alors qu’on parle d’eux constamment dans les médias des petites villes, la presse nationale écrite et parlée reste muette à leur sujet, et les sociologues ignorent superbement leur rôle capital dans la vie communautaire.
Rebutée par leurs blagues rituelles, leurs petits jeux, leurs chansonnettes, l’intelligentsia considère les membres des clubs comme des « ploucs irrécupérables ». Dès 1922, Sinclair Lewis instruit leur procès dans Babbitt, roman de moeurs d’une sauvage drôlerie qui dépeint la classe moyenne d’une jeune Amérique en ébullition. Associé d’une société immobilière dans fa ville fictive de Zenith, quelque part dans le Midwest, George Babbitt fait partie d’un club social lui aussi fictif, les Boosters. Lors d’un déjeuner- conférence, les membres, tenus de s’appeler uniquement par leur surnom sous peine d’amende, raillent lourdement celui d’entre eux qui fête son anniversaire et sont invités à fonder un orchestre symphonique, non pour développer le goût de la musique classique – que l’orateur méprise – mais pour « porter le glorieux nom de Zenith aux oreilles d’un millionnaire new-yorkais, des fois qu’il aurait l’idée d’y ouvrir une filiale » !
Aider les autres tout en s’aidant soi-même

Le règlement du club stipule que « rien ne vous oblige à faire des affaires avec les autres membres, mais posez-vous la question : pourquoi dépenser de l’argent à l’extérieur de notre belle famille ? ». Si Lewis a reçu le premier prix Nobel de littérature décerné à un Américain (en 1930), ce n’était pas par manque de fiel ! Il saisit là l’un des ressorts fondamentaux du mouvement associatif : le désir d’aider les autres tout en s’aidant soi-même. Quoi de plus humain que de servir son intérêt en même temps que celui d’autrui ? Dans le jargon contemporain, cela s’appelle du réseautage.
Brillamment écrit, l’ouvrage de Lewis a façonné une image des clubs sociaux qui confine au dogme dans les milieux intellectuels, ne serait-ce que parce que sa lecture figure au programme de tous les cours universitaires de littérature américaine. Il a enrichi la langue anglaise d’au moins deux vocables, l’un et l’autre vaguement péjoratifs : « boosterism », qui s’apparente au chauvinisme, et « babbittry », qui décrit le conformisme complaisant et inculte des « beaufs » de la classe moyenne. Mais en forçant le trait, le satiriste a aussi faussé la réalité qu’il dépeignait. Lewis ne reconnaît pas la bonne volonté et l’idéalisme de ces hommes qui portent l’épinglette de leur club comme une distinction honorifique, pas plus qu’il n’explique ce que leurs amusements ont de honteux, pour triviaux qu’ils soient.
La collectivité dans ce qu’elle a de meilleur
Non que les clubs sociaux soient irréprochables. Les Boosters sont tous des hommes de race blanche, issus de la classe moyenne, passablement à droite comme en témoigne la fureur avec laquelle ils accueillent la grève des petites gens de leur ville. Cette discrimination raciale et sexuelle n’existe plus depuis des lustres, mais les clubs recrutent encore la plus grande partie de leurs adhérents parmi les cadres et les indépendants, tout simplement parce que les gens d’affaires et membres des professions libérales peuvent plus facilement que les ouvriers et petits employés prendre le temps nécessaire pour assister à un déjeuner-conférence. Pour involontaire qu’elle soit, cette sélection socio-économique leur vaut d’être considérés comme « des bastions de l’arrogance bourgeoise », note très justement Susan Ruttan dans une récente chronique pour Southam News, alors qu’ils représentent « la collectivité dans ce qu’elle a de meilleur, tant par les liens d’amitié qu’ils permettent de tisser que par les services qu’ils rendent à la communauté ».
Les dénigreurs n’en poursuivent pas moins leur travail de sape, et ils s’attaquent à présent à l’idéal de bienfaisance du mouvement. Pour nos arbitres de la mode intellectuelle, il y aurait quelque chose de malsain à vouloir faire le bien : décret renversant, qui prouve à quel point le négativisme a gagné du terrain durant ce siècle ! Mais les membres des clubs ne suivent pas la mode, et l’intelligentsia ne leur pardonne pas de rester optimistes face une réalité qu’elle-même juge sinistre.
Il est vrai qu’ils n’ont guère d’appétit pour la philosophie moderne, compliquée et obscure. Est-ce un crime que de lui préférer ce simple et lumineux principe : agis envers les autres comme tu voudrais qu’on agisse envers toi ?
Toujours construire, jamais détruire
Au Rotary, toutes les décisions doivent être guidées par quatre principes en forme de questions : est-ce la vérité ? Est-ce équitable pour toutes les parties ? Est-ce que cela peut développer l’amitié et la bonne volonté ? Est-ce à l’avantage de tous les intéressés ? Chez les Lions, le membre est incité à résoudre en sa défaveur les ambiguïtés éthiques de sa situation, à voir dans l’amitié une fin, non un moyen, à être chiche de ses critiques et prodigue de ses louanges, à toujours construire, jamais détruire.
|
« Ce dont nous avons le plus besoin, ce n’est pas tant de réaliser l’idéal que d’idéaliser le réel. » Frederick Henry Hodge
|
Dans l’esprit de leur baptême, les Optimistes invitent leurs adhérents à voir le bon côté des choses et à faire en sorte que leur optimisme devienne réalité, à savourer les succès des autres comme ils savourent les leurs, à ne pas laisser les erreurs passées freiner leur marche en avant et à consacrer tant de temps à leur développement personnel qu’ils n’en auront plus pour critiquer les autres.
Plaidant pour l’engagement communautaire qui caractérise son organisation, Courtney W. Shropshire, fondateur de Civitan International, fait valoir qu’une force vouée au progrès civique est pour l’humanité le plus grand des trésors. Les Kinsmen et Kinettes aspirent à créer au Canada une unité de pensée et d’action en faveur du développement de la coopération, de la tolérance, de la compréhension et de l’égalité entre les peuples.
La contribution canadienne
Cette référence spécifique au Canada distingue les Kins des grandes organisations d’origine américaine. Le premier de ces clubs typiquement canadiens a vu le jour en 1920 grâce à un ancien combattant de la Première Guerre mondiale. Entré dans l’entreprise familiale de matériel de plomberie, Hal Rogers avait voulu adhérer au club Rotary de Hamilton, mais à l’époque, on n’y acceptait qu’un représentant de chaque corps de métiers, et le père de Hal occupait le siège réservé aux fournisseurs des plombiers ! Le jeune homme saisira le prétexte pour fonder une association réunissant des couples de son âge désireux de servir leur communauté, de cultiver leurs dons – et de bien s’amuser.
Le réseau des Kin Clubs déborde aujourd’hui les frontières canadiennes par son affiliation au conseil mondial des Young Men’s Service Clubs, qui regroupe de 20 à 30 associations américaines et mexicaines ainsi que les clubs Apex en Australie et Round Table au Royaume-Uni et en Irlande. Ses dirigeants estiment que les plus de 600 clubs canadiens recueillent, en proportion de leurs effectifs, plus d’argent que n’importe quel groupe de même type n’importe où dans le monde. En 1964, les Kins ont décidé de s’investir dans la lutte contre une maladie assez mal connue qui frappait les très jeunes enfants; leurs efforts ont donné naissance à la Fondation canadienne de la fibrose kystique. Dans la longue liste des activités et établissements qu’ils soutiennent figure un centre de recherche sur l’arriération mentale de l’université York, à Toronto, le Kinsmen National Institute on Mental Retardation.
|
« La seule aventure digne d’être vécue aider les autres. » Gamaliel Bailey
|
Au moins une organisation canadienne s’est internationalisée par ses seuls moyens : Richelieu International, un groupe francophone fondé à Ottawa en 1944. Il compte plus de 200 clubs au Québec, en Ontario et dans les Maritimes, 18 antennes aux États-Unis, 44 en France, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse, plus des partenaires en Afrique, en Europe de l’Est, en Amérique du Sud et dans les Antilles. Sa spécialité : le développement socioculturel et l’aide humanitaire dans le monde francophone.
Rayonnement mondial, présence locale
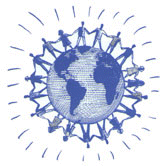
C’est dans le Tiers Monde que les grandes organisations internationales font aujourd’hui la plus belle démonstration de leur efficacité. Les campagnes de vaccination du Rotary y font reculer à grands pas les cinq principales maladies d’enfance. Un programme des Lions a sauvé la vue d’un nombre incalculable d’enfants. Kiwanis International combat l’arriération mentale et les déficits intellectuels en finançant le dépistage des carences en iode, qui constituent la première cause non génétique de ces handicaps dans le monde.
Cette démarche transparente et idéaliste fait des adeptes sur les cinq continents. Les 1,4 million de membres des Lions animent 43 000 clubs dans 181 pays. Le Rotary rassemble 1,2 million d’adhérents dans plus de 29 000 clubs couvrant 160 pays, et Kiwanis compte 300 000 affiliés et 7 000 antennes dans 60 pays. Même des clubs plus petits comme Y’sdom International, Zonta International et Civitan opèrent à l’échelle mondiale. Dans toutes les organisations-phare, les jeunes ont leur propre réseau. L’engagement local témoigne en parallèle de la générosité individuelle des adhérents : comment ne pas respecter la jeune femme qui repeint le chalet où le Rotary veut héberger des enfants handicapés, admirer l’Optimiste quadragénaire qui arpente de nuit les rues de sa ville pour tenter de sauver quelques adolescents paumés, applaudir le membre du Canadian Progress Club qui fait la quête au coin d’une rue à Terre-Neuve pour financer les Jeux olympiques spéciaux et la Kinette qui se lève à l’aube pour entraîner une équipe de hockey amateur ?
Plus nécessaire que jamais
Jimmy Carter, qui a commencé dans un club des Lions une vie publique couronnée par la présidence des États-Unis, a parfaitement résumé l’idéal du mouvement dans un discours sur la vie à Plains, la ville de Géorgie qui l’a vu naître : « Tout ce qui se faisait, se faisait grâce aux Lions. Si une veuve avait un problème, qui allait-elle voir ? Le maire ? Non, les Lions. » Malgré de vigoureuses campagnes de recrutement, notamment dans les écoles secondaires, les clubs connaissent, hélas, une inquiétante désaffection. Difficile d’assurer la relève d’un mouvement altruiste dans le climat d’égoïsme sacré qui règne actuellement ! Dans toute l’Amérique du Nord, les rangs des clubs s’éclaircissent, et l’âge moyen augmente.
Pourtant, le bénévolat est plus nécessaire que jamais depuis les coupes sombres pratiquées dans les budgets publics. Et l’approche pragmatique des clubs a toujours donné de meilleurs résultats que les méthodes bureaucratiques des fonctionnaires.
Si les clubs dépérissent, toute la communauté s’appauvrit – or, qu’est-ce qu’une nation, sinon une communauté de communautés ? Pour que ces piliers de nos collectivités puissent attirer des membres en nombre suffisant, il faudrait sans doute que la société cesse de les tenir pour quantité négligeable. Il est temps de donner aux porteurs et porteuses de leurs épinglettes la place d’honneur qu’ils ont si largement méritée.

