Alors que l’intelligence artificielle se généralise, le Canada est à la croisée des chemins : malgré ses centres de recherche de premier plan et son solide bassin de talents, le pays prend du retard dans la course à l’adoption de l’IA menée par les concurrents internationaux. Le problème ne réside pas dans un déficit de technologies ou de compétences, mais dans une sorte de blocage imaginatif, une incapacité généralisée des entreprises canadiennes, et notamment des PME, à percevoir l’intérêt et les avantages de l’IA pour leur activité. Le Canada, avec 12 % seulement des organisations qui ont intégré l’intelligence artificielle dans leur production ou leurs services, figure parmi les derniers en ce qui concerne l’adoption de l’IA dans l’OCDE. Les données de l’OCDE montrent également que le nombre de cas d’utilisation de l’IA envisagés par les sociétés canadiennes est plus restreint que dans les autres pays.
Les avantages sont pourtant sans équivoque. Un sondage récent de la Business Development Bank of Canada révèle que 97 % des PME qui utilisent l’IA constatent des avantages concrets. Les données de Statistique Canada montrent que l’incidence de l’IA sur la réduction des tâches est particulièrement marquée dans les entreprises de moins de 100 employés, ce qui souligne le fort potentiel de ces technologies pour les PME. Le sujet de l’adoption de l’IA figurait à l’ordre du jour du sommet du G7, qui s’est tenu à Kananaskis, en Alberta, puisque les chefs d’État se sont engagés à « redoubler d’efforts » en la matière afin d’améliorer la prospérité.
Pour mieux comprendre pourquoi les entreprises canadiennes peinent à adopter l’intelligence artificielle, Leadership avisé RBC s’est associé à la Munk School of Global Affairs and Public Policy de l’Université de Toronto pour réaliser plus d’une vingtaine d’entrevues approfondies avec des cadres supérieurs des secteurs privé et public et du monde des technologies au Canada. Voici ce que nous avons appris sur les freins rencontrés par les sociétés de toutes les tailles, et les enseignements tirés des organisations qui n’ont pas hésité à relever le défi de l’IA.
1. Le dilemme du pionnier : des coûts certains, des avantages incertains
Parmi les entreprises qui tardent à se mettre à l’IA, certaines sont victimes d’une forme d’inertie : si les coûts d’adoption sont immédiats et bien concrets, les avantages semblent obscurs et distants. Pour les directeurs de la technologie, les projets liés à l’intelligence artificielle nécessitent des investissements initiaux conséquents, mais ils peuvent aussi coûter cher sur le plan de la réputation en cas d’échec. Comme l’admettent certains cadres interrogés, en optant pour une adoption tardive, la société prend le risque d’accumuler du retard par rapport aux concurrents qui ont pris les devants. Le pari est à double tranchant : agir rapidement et risquer de perdre le peu de capital et de personnel disponible, ou attendre et risquer de passer à côté d’un avantage concurrentiel.
Plusieurs dirigeants du secteur des technologies remarquent qu’à cause de ces incertitudes, l’obtention des autorisations est souvent repoussée de 6 à 12 mois. À cela s’ajoute une certaine frustration face au fait que bon nombre de chefs d’entreprise canadiens ne voient pas les avantages dont bénéficient déjà leurs concurrents grâce à l’IA. Les concepteurs de technologies affirment même convaincre davantage lorsqu’ils présentent leurs solutions d’IA aux divisions américaines des entreprises canadiennes.
Pour surmonter ces obstacles, les leaders recommandent de quantifier clairement les investissements dans l’IA en comparant les coûts de l’action immédiate à ceux de l’inaction. Certains outils comme les tableaux de bord permettant de calculer les « coûts du retard » peuvent aider les entreprises à prendre conscience de ce qu’elles ont à perdre.
Bell Canada : surmonter le biais d’inertie
Lorsque GPT-4 est arrivé sur le marché, début 2023, le directeur de Bell Canada a immédiatement voulu savoir ce qui lui en coûterait de ne pas s’en saisir. En quelques semaines, le président du groupe a organisé deux tutoriels à l’attention du conseil d’administration et dévoilé une analyse mettant en balance la perte de productivité et le coût modeste de projets pilotes. Ces chiffres ont été déterminants, puisque des capitaux ont été débloqués au cours du trimestre pour financer des applications d’IA. Les 50 000 appels de clients quotidiens sont désormais analysés en temps réel, et cette technologie met en évidence des points de friction qui étaient auparavant noyés dans des échantillons anecdotiques. Les demandes sont maintenant traitées avec plus de précisions par des agents conversationnels et de clavardage.
Encourager une « culture de l’entrepreneuriat et de l’expérimentation » a également permis à Bell Canada d’imaginer des utilisations innovantes de l’IA qui améliorent largement les processus de communication, les flux de travail et la satisfaction des clients.
2. Formation à l’IA : dépasser les appréhensions pour saisir les occasions
Par peur de perdre leur emploi ou par méconnaissance des avantages de cette technologie, les Canadiens se montrent sceptiques face à l’intelligence artificielle. Une étude KPMG récente montre que 79 % d’entre eux s’inquiètent des conséquences négatives de l’IA. On estime que dans le pays, moins d’un quart des employés ont déjà suivi une formation sur l’intelligence artificielle. La grande majorité des Canadiens ne l’a tout simplement pas suffisamment utilisée pour la démystifier.
Il est toujours utile d’avoir un défenseur de l’IA ou une unité opérationnelle dédiée à l’expérimentation et à la mise en œuvre, mais pour être adoptée largement, cette technologie ne doit pas rester la chasse gardée d’un petit nombre. Nos recherches montrent que les entreprises qui forment leur personnel bénéficient d’une expansion plus rapide des projets d’IA, d’une meilleure mobilisation des employés et d’une confiance générale accrue. La connaissance est un puissant catalyseur pour l’innovation continue et la différenciation concurrentielle.
Hopper : mettre à niveau les aptitudes du personnel pour plus d’efficacité
Au lieu de les remplacer par l’IA, Hopper, une plateforme de voyage établie à Montréal, a formé son personnel d’assistance à des postes axés sur la production de contenus, l’entraînement et les tests de l’intelligence artificielle. Cette mise à niveau des aptitudes pour intégrer l’IA dans les fonctions de l’assistance clientèle a eu raison de l’hésitation des employés, mais elle a aussi permis à Hopper de réduire de 75 % le délai de traitement moyen initial des demandes des clients, qui était de 15 à 20 minutes et a chuté à entre 3 et 5 minutes. Cette stratégie, qui n’a par ailleurs pas nui à la satisfaction des clients, coûte ainsi 90 % moins cher environ que les interactions exclusivement humaines.
Les organisations canadiennes qui ont adopté l’IA avec le plus de réussite reflètent les expérimentations menées à la base (employés « augmentés » qui rédigent déjà des consignes, déploient des correctifs et créent des prototypes grâce aux outils d’IA générative) dans le cadre d’une mission de transition voulue par la direction. Mais si la base est seule à agir, les TI « dans l’ombre » prolifèrent et les chefs de file s’essoufflent par manque de budget ou de pouvoir d’approbation des risques. À l’inverse, si la direction est seule à donner l’impulsion, les initiatives sont perçues comme imposées et le personnel ne manque pas de reprendre ses anciennes habitudes.
Lumberhub : une « superagentivité » ascendante dans un secteur traditionnel
Au moment où une inertie tarifaire chronique s’est installée entre les différentes scieries et où les constructeurs de maisons ont commencé à réduire leurs marges, George McKeown, chimiste reconverti dans le commerce du bois d’œuvre, s’est posé une question simple : Pourquoi accepterions-nous ce manque d’efficacité ?
Sa maîtrise du codage étant insuffisante, il s’est tourné vers des collègues programmeurs travaillant avec des outils d’IA génératives pour écrire plus de 40 000 lignes de code. En moins de trois mois, il a créé une application Web classique React/Typescript fonctionnant sur Amazon Web Services qui acquiert des données en temps réel sur les contrats à terme, produit des devis dynamiques pour chaque référence produit et génère automatiquement les bons de commande pour les fournisseurs.
-
L’intelligence artificielle est utilisée comme un optimisateur, et non comme produit final : la plateforme fonctionne avec les langages classiques SQL et Python ; son code a été écrit beaucoup plus rapidement grâce à des outils de type Copilot.
-
Les avantages sont immédiats : le délai entre le devis et la commande, qui se comptait auparavant en jours, est désormais de quelques minutes, ce qui permet de modérer les fluctuations de prix volatils et sources d’inefficacité.
-
La direction a été motrice : après avoir assisté à une démonstration en direct, le chef de la direction a fait en sorte que l’entreprise définisse un budget pour affiner le prototype et l’intégrer au système de planification des ressources.
3. La paralysie du choix face à une multitude de cas d’utilisation
L’intelligence artificielle a ouvert un incroyable champ des possibles. Les technologues partent du principe que tous les processus, produits et points de contact des clients peuvent être automatisés. Mais l’abondance peut inhiber l’action et engendrer une sorte de « paralysie du choix ». Le blocage réside souvent dans le choix du tout premier cas d’utilisation. Pour accélérer le processus décisionnel, certaines entreprises font appel à l’expertise de leur personnel en organisant par exemple des « tournois de cas d’utilisation » afin d’évaluer leurs options.
Mais même lorsqu’un programme pilote est choisi et mis en place, les entreprises canadiennes de taille moyenne rencontrent souvent des obstacles importants au moment de les faire évoluer. Au cours de nos entrevues, nous avons relevé trois principaux freins aux initiatives liées à l’IA :
-
Épuisement des financements : Il est fréquent que les aides publiques financent les équipements ou le personnel pendant les premières phases des projets seulement, et ne couvrent pas les coûts d’intégration, de formation et d’adaptation subséquents. De nombreux projets s’arrêtent prématurément parce que ces frais sont habituellement financés par les budgets opérationnels et non sous forme de dépenses en immobilisations.
-
Perte des personnes motrices : Celles et ceux qui pilotent les projets, comme les directeurs d’usine ou les responsables TI, sont souvent promus ou mutés après le début du projet pilote. Leurs successeurs héritent alors des risques sans montrer le même enthousiasme et sans avoir une vision aussi claire du projet initial.
-
Perte du rendement du capital investi en cours de route : Les avantages concrets essentiels pour l’expansion sont rarement abordés pour décider de la répartition des fonds propres. Les améliorations techniques proposées par les ingénieurs doivent se traduire par des projections claires en matière de flux de trésorerie. Les charges d’exploitation potentielles doivent donc être explicitement justifiées par des avantages sur le plan de la trésorerie, et non par des indicateurs abstraits comme le « nombre de défauts par millions d’opportunités ».
4. Données fragmentées et de piètre qualité
De nombreux cadres interrogés expliquent avoir dû faire des pieds et des mains pour rendre l’utilisation de l’IA possible, et insistent sur le caractère fondamental de l’architecture des données. Certains font aussi état d’une pénurie de données de production de qualité dans le secteur manufacturier. Comme il est par ailleurs problématique d’unifier différents ensembles de données, les difficultés au niveau de l’intégration des données finissent par mettre en échec ou retarder la mise en place de l’IA. Avant même d’envisager d’utiliser des outils d’intelligence artificielle, des investissements initiaux conséquents sont souvent nécessaires pour améliorer la qualité, la fiabilité et la gouvernance des données. Cette étape a tendance à être dissuasive pour les entreprises.
Il est primordial de renforcer les infrastructures de données du Canada en construisant de solides écosystèmes prêts pour l’IA. De nombreuses PME, dont près de la moitié ont plus de 20 ans, rencontrent d’importants obstacles pour adapter leurs anciens systèmes et leurs ensembles de données fragmentés. Dans les anciens systèmes de gestion de l’information, les données sont enregistrées dans des formats incompatibles, et elles sont truffées de lacunes et de doublons. Ce travail de nettoyage et de réparation de ces sources épuise souvent les équipes et les budgets bien avant que les avantages se concrétisent.
Hôpital St. Michael : ce que le cloisonnement des données fait perdre au Canada
Créée pour permettre la constitution de grands ensembles de données et améliorer le secteur de la santé, GEMINI est la plus grande plateforme de données hospitalières pour la recherche du Canada.
Si elle regroupe déjà plus de 60 % des établissements hospitaliers de l’Ontario et soutient plus de 1 000 cliniciens par le biais d’une bourse de recherche de 140 millions de dollars, la plateforme rencontre encore certaines difficultés. Le réseau disparate des systèmes hospitaliers et leurs formats de données incompatibles ralentissent les processus de gouvernance, et les cycles d’actualisation des données trop peu fréquents empêchent les progrès. Ces freins mettent en lumière ce que le Canada perdra si l’on ne redouble pas d’efforts en matière d’intégration des données.
Les plateformes comme GEMINI sont capables d’associer automatiquement des patients à des essais cliniques et d’enregistrer efficacement les données de santé, ce qui permet de réduire le coût des essais de 80 % et d’accroître l’attractivité du Canada en la matière. Des ensembles de données détaillées et à grande échelle sont essentiels pour utiliser l’IA dans le domaine de la santé. GEMINI et ses partenaires en Alberta et au Québec ont commencé à agir pour dépasser les freins et souhaitent créer un réseau de partage de données en temps quasi réel regroupant 100 établissements, baptisé VITAL. Il est primordial d’avoir accès à des ensembles de données aussi vastes et détaillés que ceux de GEMINI pour développer l’intelligence artificielle dans la santé. Ils seront déterminants pour permettre au Canada de se démarquer dans ce secteur.
5. Angles morts : de l’importance de ce que l’on ne soupçonne pas
Il n’est pas rare d’investir dans l’IA pour automatiser ce que l’on connaît (tâches répétitives) ou pour analyser les inconnues connues (questions que l’on peut formuler, mais auxquelles on ne peut répondre). Certaines grandes réussites découlent pourtant des inconnues inconnues, c’est-à-dire de ce qui manquait aux dirigeants, mais dont ceux-ci n’étaient pas conscients avant que le modèle d’IA ne le pointe du doigt.
En observant des années de données capteurs, de journaux d’appels ou de documents d’expédition, les modèles d’intelligence artificielle peuvent repérer des corrélations et des anomalies qui échappent à l’analyse humaine : une consommation électrique excessive sur une ligne de production, par exemple, ou des microcoupures à répétition sur un réseau de distribution, ou encore des occasions de ventes croisées insoupçonnées en commerce électronique. L’analyse des budgets, des indicateurs clés de rendement et des risques étant pensée pour certains problèmes définis, la capacité de l’IA à en révéler de nouveaux élargit les horizons opérationnels d’une entreprise.
Linamar : transformer les « inconnues inconnues » en avantage concurrentiel
La possibilité de repérer les sources d’inefficacité cachées et de trouver des solutions inattendues dans des environnements de production complexes transforme la manière dont Linamar voit les données négligées, ce qui recèle des avantages concurrentiels concrets.
Quand Linamar a injecté 10 ans de données d’atelier dans la plateforme d’IA et d’analyse industrielle Acerta LinePulse, la première surprise a été de découvrir plusieurs microfluctuations dans la pression de la pompe que les ingénieurs n’avaient jamais relevées. En résolvant ce problème, l’entreprise a pu éliminer une source de coûts silencieux dans son processus de production de pièces pour les boîtes de vitesses de véhicules électriques. L’outil d’apprentissage automatique du logiciel chargé d’analyser les causes profondes a ensuite su déceler la variable en amont qui causait le plus « de bruit, de vibrations et de rugosité » parmi plus de 100 paramètres qu’aucun humain n’aurait pu corréler en temps réel. Sur une autre ligne de production, le modèle d’IA a mis le doigt sur un goulet d’étranglement dans la ligne d’assemblage qui ralentissait la productivité.
En utilisant une plateforme d’IA industrielle capable de résoudre les problèmes dans la plupart des environnements de production discrète, Linamar ne s’est pas contenté de faire des économies ponctuelles. L’entreprise en a fait un outil diagnostic permanent dont chaque analyse permet de libérer des capacités, de résoudre des problèmes de commercialisation, et même d’élargir la clientèle.
6. Infrastructure numérique : le Canada est à la traîne en matière de capacité de calcul
De la même manière que la croissance économique reposait jadis sur les chemins de fer et les réseaux électriques, l’innovation nécessite aujourd’hui de solides capacités de calcul pour l’IA, c’est-à-dire des superordinateurs et des groupes d’UTG. Le Canada accuse pour l’instant un retard conséquent dans un contexte de demande croissante en matière d’entraînement et de déploiement de modèle d’IA de pointe. Derrière tous les pays membres du G7, le Canada possède huit à dix fois moins de puissance de calcul disponible par personne par rapport à d’autres pays comme les États-Unis. Ces lacunes nationales pourraient bien freiner les innovateurs canadiens, alors que certains pays proposent à leurs entreprises et chercheurs en IA des infrastructures conséquentes et subventionnées. Par ailleurs, le recours par les institutions canadiennes à des fournisseurs de services infonuagiques étrangers présente des risques accrus pour la souveraineté, la sécurité et la résilience économique en ce qui concerne les données sensibles et l’utilisation de l’IA au sein du gouvernement.
Les cadres interrogés expliquent que faire la queue pour accéder aux capacités de calcul nationales peut rallonger les délais d’entraînement de plusieurs heures, voire de plusieurs jours, ce qui fait drastiquement chuter la vitesse d’itération. Les règles sur les marchés publics et la prudence du secteur public en ce qui concerne les achats freinent aussi la constitution de groupes souverains susceptibles d’attirer des locataires majeurs. Sans « crédits d’utilisation » ciblés ni infrastructure commune, même les plus éminents chercheurs ne peuvent pas totalement commercialiser leurs modèles dans leur pays.
À l’échelle des provinces, certaines initiatives comme l’Artificial Intelligence Data Centres Strategy (stratégie en matière de centres de données pour l’intelligence artificielle), en Alberta, contribuent à aligner les atouts locaux (aptitudes ou énergie, par exemple) avec les perspectives économiques offertes par les infrastructures liées à l’intelligence artificielle. Ces projets viennent compléter avantageusement les stratégies fédérales qui incitent au développement général de ces infrastructures.
Certaines initiatives fédérales récentes, notamment la Stratégie canadienne sur la capacité de calcul souveraine pour l’IA et ses 2 milliards de dollars de budget, représentent des mesures importantes pour rattraper le retard. Le premier projet entrepris dans ce cadre, un partenariat national de superinformatique entre Cohere et CoreWeave, permettra ainsi aux entreprises d’IA canadiennes d’utiliser des ressources informatiques essentielles sur le territoire national. L’accélération et l’élargissement de ces investissements stratégiques pourraient renforcer considérablement les infrastructures liées à l’IA au Canada et permettre la mise au point de solutions rapide et sécurisée sans recours à des prestataires externes.
7. Réglementation et politiques : entre redondance et incertitude
La responsabilité réglementaire est actuellement répartie entre plusieurs acteurs, notamment Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, le Bureau de la concurrence, ainsi que des organismes de réglementation sectoriels comme Santé Canada et Transports Canada. De plus en plus, les provinces élaborent leurs propres recommandations (modifications de Loi 25 du Québec concernant la vie privée, par exemple), ce qui donne naissance à ce que certains qualifient de « mini-UE » où coexistent 13 régimes distincts.
L’absence de leadership fédéral constitue un obstacle réglementaire majeur évoqué au cours de la plupart des entrevues. Les tentatives récentes, et notamment la Loi sur l’intelligence artificielle et les données, sont tombées à l’eau suite à des difficultés politiques. Cette loi a été critiquée pour ses exigences lourdes et excessivement prudentes en matière de conformité, mais aussi pour des lacunes procédurales et une mobilisation inadéquate des parties prenantes. Le Canada gagnerait à avoir un cadre réglementaire clair qui favorise l’innovation, implique une réelle participation du public et permet concrètement la mise en place de l’IA.
Cette absence de lignes directrices fédérales touche les PME, pilier de l’économie canadienne, de façon disproportionnée. Les plus petites entreprises aux ressources généralement limitées ont du mal à lire entre les lignes des ambiguïtés réglementaires et hésitent donc à investir dans l’intelligence artificielle. Les dirigeants du secteur des technologies interrogés par RBC sont nombreux à déplorer l’incertitude persistante et l’excès de prudence engendrés chez les entreprises par les effets d’annonce répétés qui ne sont jamais suivis de recommandations concrètes. Inquiètes des futurs coûts de conformité en cas de durcissement des réglementations, les organisations se cantonnent donc aux cas d’utilisation classiques de l’IA. Un peu de clarté serait réellement bénéfique.
Conclusion : cinq conseils pour les dirigeants
Malgré les obstacles, nombreuses sont les entreprises canadiennes qui ont réussi à intégrer l’IA dans leur activité et qui en retirent des avantages concurrentiels. Pour réussir, les entreprises :
-
Quantifient ce qui leur coûterait d’agir et de ne rien faire pour s’assurer que la répartition des fonds propres est décidée en connaissance de cause, en sachant les risques et les avantages de l’IA
-
Sensibilisent leurs employés aux avantages de l’IA et leur apprend à utiliser ces technologies, à la fois pour les faire avancer dans leur carrière et pour accroître l’efficacité opérationnelle de l’organisation
-
Sortent de la torpeur liée à la paralysie du choix en intégrant des employés dans le processus d’évaluation et en leur donnant les moyens de mettre en œuvre des solutions
-
Investissent dans la gouvernance des données pour disposer de données uniformisées, consolidées et prêtes pour l’IA
-
Définissent un budget « exploratoire » en réservant une partie des dépenses annuelles dédiées à l’IA à l’exploration de données ouverte afin de ne pas passer à côté d’occasions difficiles à repérer ; en cultivant cet état d’esprit chez leur personnel, ces entreprises transforment chaque nouvel ensemble de données en terrain de chasse permettant de repérer des sources d’inefficacité cachées et des occasions de croissance
Responsable du projet :
Reid McKay, directeur général et responsable principal, Politique technologique, Leadership avisé RBC
Contributeurs
Jordan Brennan, chef, Leadership avisé RBC
Jaxson Khan, conseiller spécial
Nicole Harris, étudiante de deuxième cycle, Munk School of Public Affairs
Nora Bieberstein, directrice générale, Programmes stratégiques, Leadership avisé RBC
Niki McKeown, associée, Recherche, Leadership avisé RBC
Shiplu Talukder, spécialiste, Publication numérique
Merci à Daniel Diamond, Daniel Ebrahimpour, Janelle Gunaratnam, Anya Haldemann, Nikhil Konduru, Patrycja Maszlejak, Georgia Maxwell, Andrew Scarlato, Sabreena Shukul, Avaani Singh, Mia Sunner et Sydney Wisener.
Représentants de la direction
John Stackhouse, premier vice-président, Bureau du chef de la direction, RBC
Janice Stein, fondatrice et directrice de la Munk School of Global Affairs and Public Policy
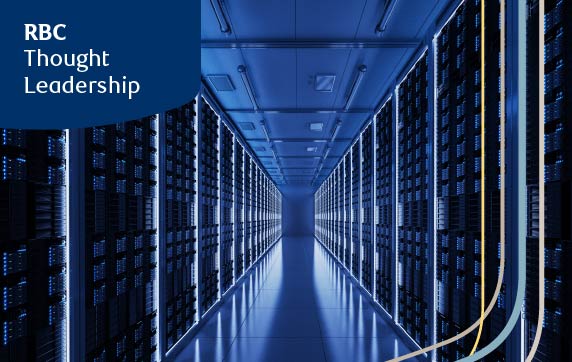
Télécharger le rapport
Le présent article vise à offrir des renseignements généraux seulement et n’a pas pour objet de fournir des conseils juridiques ou financiers, ni d’autres conseils professionnels. Le lecteur est seul responsable de toute utilisation des renseignements contenus dans le présent document, et ni la Banque Royale du Canada (« RBC »), ni ses sociétés affiliées, ni leurs administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires respectifs ne seront tenus responsables des dommages directs ou indirects découlant de l’utilisation du présent document par le lecteur. Veuillez consulter un conseiller professionnel en ce qui concerne votre situation particulière. Les renseignements présentés sont réputés être factuels et à jour, mais nous ne garantissons pas leur exactitude et ils ne doivent pas être considérés comme une analyse exhaustive des sujets abordés. Les opinions exprimées reflètent le jugement des auteurs à la date de publication et peuvent changer. La Banque Royale du Canada et ses sociétés affiliées ne font pas la promotion, explicitement ou implicitement, des conseils, des avis, des renseignements, des produits ou des services de tiers.
Le présent document peut contenir des déclarations prospectives – au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières – qui font l’objet de la mise en garde de RBC concernant les déclarations prospectives. Les paramètres, données et autres renseignements ESG (y compris ceux liés au climat) contenus sur ce site Web sont ou peuvent être fondés sur des hypothèses, des estimations et des jugements. Les mises en garde relatives aux renseignements présentés sur ce Site Web sont exposées dans les sections « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » et « Avis important concernant le présent rapport » de notre Rapport climatique le plus récent, accessible sur notre site d’information à l’adresse https://www.rbc.com/notre-impact/information-sur-la-durabilite/index.html. Sauf si la loi l’exige, ni RBC ni ses sociétés affiliées ne s’engagent à mettre à jour quelque renseignement que ce soit présenté dans le présent document.


