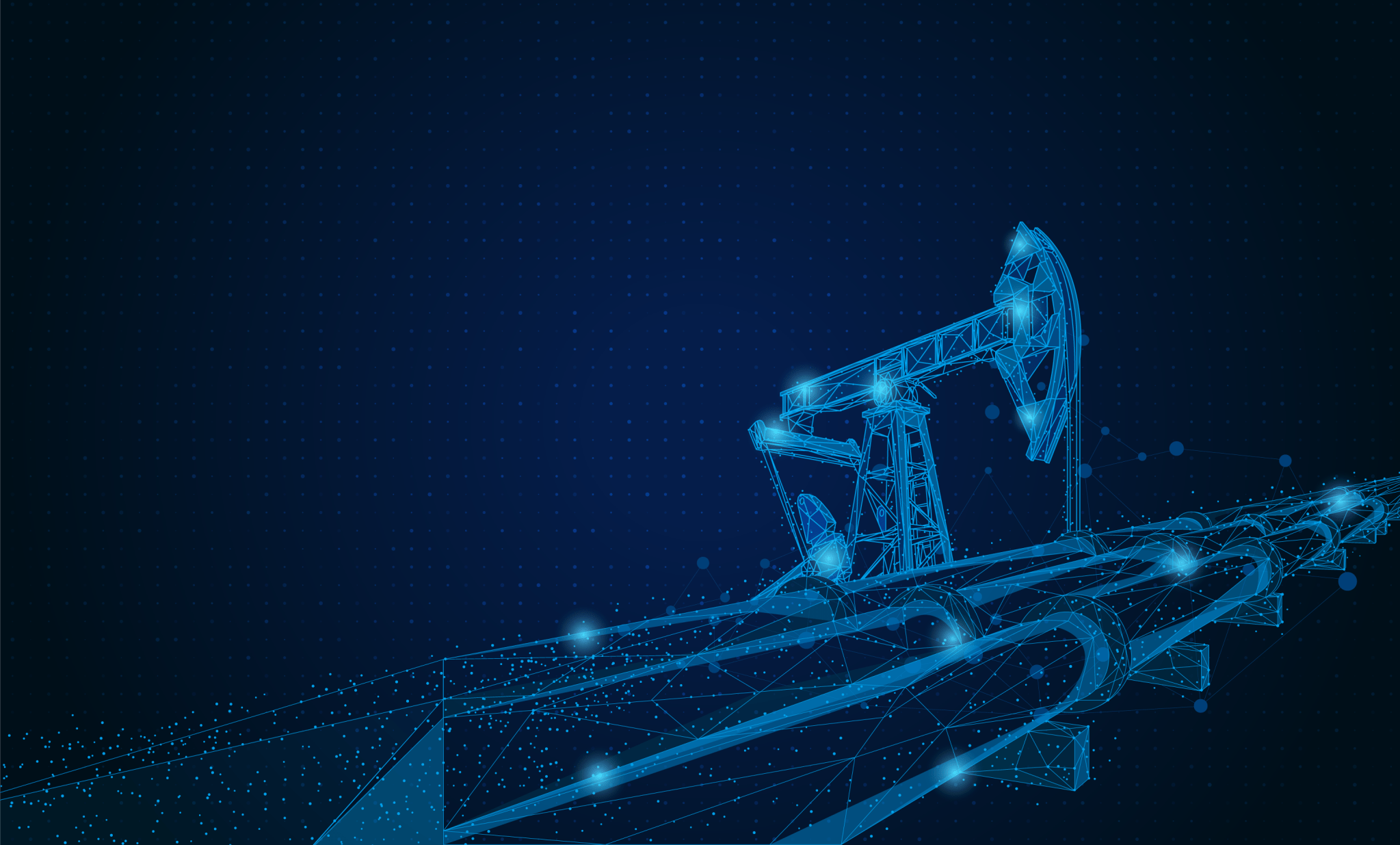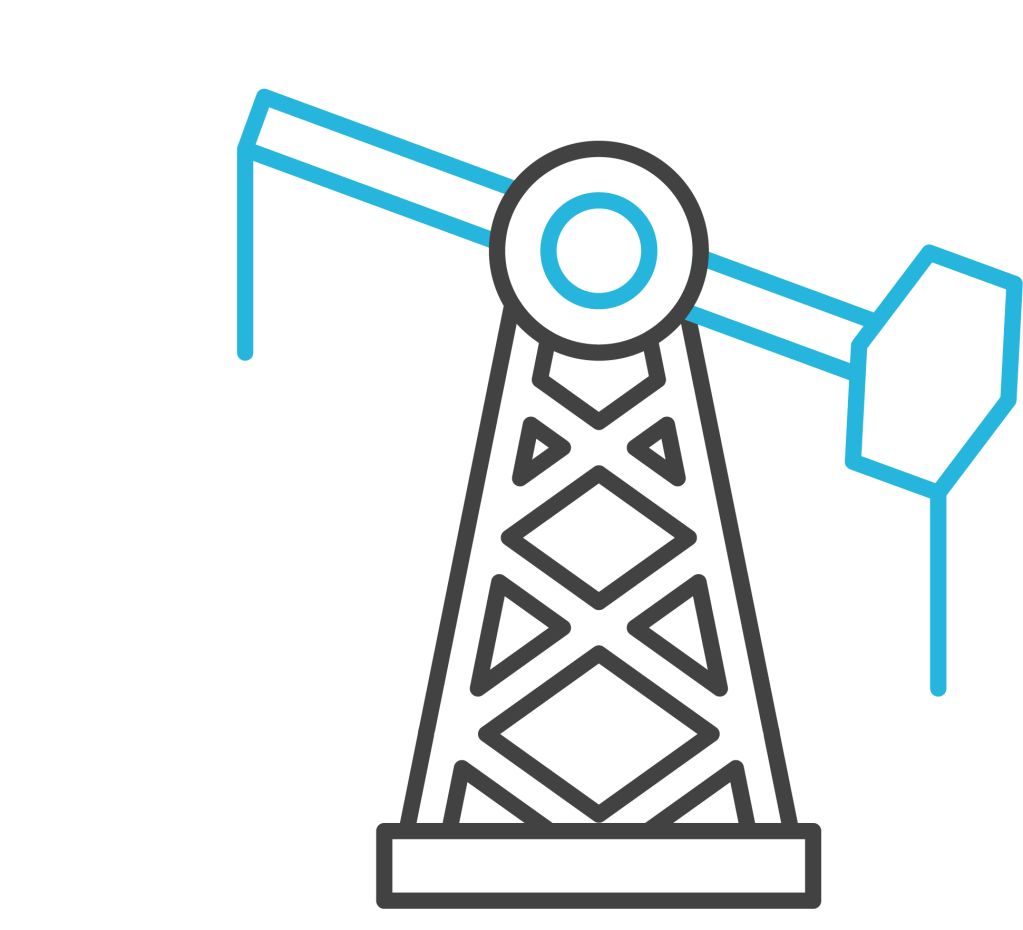
Le conflit au Moyen-Orient a fait fluctuer les prix pétroliers de façon spectaculaire ces derniers jours, suscitant des inquiétudes quant aux conséquences pour l’économie canadienne d’exportation de pétrole.
Toutefois, la hausse nette des prix de référence mondiaux a été relativement limitée. Même les niveaux les plus élevés atteints après les premières attaques sont restés inférieurs aux sommets de 2025 enregistrés à la mi-janvier, et les prix sont revenus à des niveaux peu différents de ceux d’il y a deux semaines (au 24 juin).
Les répercussions économiques des variations des prix pétroliers dépendent des facteurs qui les influencent. Par exemple, il est peu probable que la volatilité des prix due à des événements géopolitiques soit considérée comme suffisamment persistante pour modifier les plans d’investissement des entreprises, alors que les changements structurels dans l’offre et la demande mondiales de pétrole ont conduit à un recul marqué des investissements dans le secteur pétrolier et gazier canadien il y a une dizaine d’années.
Néanmoins, une aggravation de la situation pourrait faire grimper les prix et créer davantage d’incertitude dans le contexte économique déjà complexe du Canada. Dans cette optique, nous examinons comment les fluctuations des prix pétroliers pourraient influer sur l’économie canadienne et pourquoi les risques pourraient avoir changé par rapport au passé.
Des prix à la consommation plus élevés, mais des revenus plus importants pour les régions productrices de pétrole
À court terme, la hausse des prix pétroliers devrait avoir un effet neutre sur le produit intérieur brut du Canada. Elle entraîne une augmentation des coûts pour les ménages, mais elle stimule également les revenus du secteur pétrolier et gazier, en accroissant les bénéfices des entreprises et les redevances des gouvernements provinciaux.
Les consommateurs doivent faire face à des prix plus élevés à la pompe presque instantanément lorsque les prix pétroliers augmentent. Comme il s’agit d’un achat essentiel, ces coûts accrus réduisent le pouvoir d’achat des ménages et, s’ils sont suffisamment importants, peuvent faire baisser la demande d’autres biens et services.
Toutefois, puisque le Canada est un grand exportateur de pétrole, la hausse des prix pétroliers se traduit par une augmentation des revenus tirés de la production de pétrole et de gaz. Le secteur pétrolier et gazier représente une part moins importante de l’économie qu’avant la chute des prix et des investissements en 2015. Pourtant, il compte encore directement près de 7 % de l’économie canadienne.
Le problème, c’est que les avantages découlant de l’augmentation des bénéfices des entreprises et des redevances sur les ressources naturelles versées aux gouvernements provinciaux sont généralement concentrés dans les régions productrices de pétrole, tandis que le coût de la hausse des prix de l’essence touche l’ensemble des consommateurs.
Une incidence limitée sur les investissements qui ne se redressent pas depuis 2015
Fait important, la hausse des prix pétroliers due à l’instabilité géopolitique n’entraînera pas une reprise des dépenses d’investissement dans le secteur. Toute hausse des prix due à l’instabilité géopolitique ne sera pas considérée comme suffisamment durable pour justifier le type d’investissements à forte intensité de capital qui sont restés pour la plupart inactifs au cours de la dernière décennie dans les sables bitumineux canadiens.
Bien sûr, la volatilité et l’incertitude peuvent aussi nuire à l’investissement, mais l’investissement dans le pétrole et le gaz au Canada ne s’est pas remis de l’effondrement des prix en 2015. Les investissements dans le secteur sont passés de 3,9 % du PIB en 2014 à moins de 2 % en 2019, et à 1,5 % en 2024. En raison du faible nombre de nouvelles constructions dans les sables bitumineux, les dépenses se sont concentrées sur l’optimisation de la production et de la maintenance, et ce type d’investissement est moins sensible aux variations du prix pétrolier.
Les effets sur l’inflation sont modérés en dehors des produits énergétiques
Les répercussions des prix pétroliers sur l’inflation en général, en dehors de l’incidence directe sur les prix de produits tels que l’essence et les carburants, dépendent de la durée du choc des prix.
L’augmentation des coûts de l’énergie fait grimper les frais de déplacement, ce qui peut entraîner en conséquence une hausse des prix des marchandises. Toutefois, il faut du temps pour que ces pressions se répercutent sur les chaînes d’approvisionnement, et des mois de hausse des prix sont généralement nécessaires, plutôt que des jours ou des semaines, avant de créer une inflation générale importante.
Les tendances historiques incitent à la prudence dans les prévisions concernant la persistance des hausses des prix d’origine géopolitique. Les conflits peuvent provoquer des flambées spectaculaires, mais ces hausses s’atténuent souvent rapidement à mesure que les marchés s’adaptent à la situation ou que d’autres sources d’approvisionnement apparaissent. Les variations du prix pétrolier ont également beaucoup moins de conséquences, car le secteur des services du Canada représente la majeure partie des dépenses de consommation.
Nous estimons que si les prix pétroliers devaient augmenter jusqu’à environ 75 $ le baril pendant le reste de l’année 2025, la croissance de l’indice des prix à la consommation d’une année sur l’autre serait, à la fin de 2025, supérieure d’environ 0,4 point de pourcentage à notre prévision actuelle de 1,9 %. Cette différence est importante, mais elle se situe dans la fourchette de ce qui est considéré comme une volatilité normale des prix à la consommation. À titre de comparaison, une hausse des prix de 0,4 point de pourcentage représente moins d’un écart type des variations de l’inflation globale mensuelle au Canada au cours des deux dernières décennies.
Moins de vulnérabilité des États-Unis au choc pétrolier signifie moins de risques pour les exportations canadiennes
L’économie canadienne reste étroitement liée aux États-Unis. Les droits de douane imposés par l’administration américaine devraient réduire la demande des États-Unis pour les produits étrangers, ce qui aura une incidence négative sur la production canadienne cette année.
Toutefois, la vulnérabilité de l’économie américaine face à un choc pétrolier a considérablement évolué au cours des dernières décennies. La production pétrolière des États-Unis est passée de 5,4 millions de barils par jour en 2004 à 13,3 millions en 2024, soit une augmentation d’environ 1,7 fois la production pétrolière annuelle totale du Canada (4,6 millions) l’année dernière. Cette évolution a rendu l’Amérique autosuffisante sur le plan énergétique et moins vulnérable aux chocs pétroliers mondiaux.
Les États-Unis sont désormais un important exportateur net de produits énergétiques (pétrole et gaz naturel) en dehors de l’Amérique du Nord et, comme le Canada, ils sont à la fois victimes des difficultés des consommateurs et bénéficiaires des gains des producteurs lorsque les prix pétroliers augmentent. Cela limitera les effets de débordement négatifs sur les exportations canadiennes.
Il est peu probable que la Banque du Canada réagisse
La Banque du Canada fixe les taux d’intérêt pour l’ensemble de l’économie et doit donc tenir compte à la fois des répercussions des prix pétroliers sur les prix à la consommation et de l’incidence plus ciblée sur les revenus des entreprises et des gouvernements dans les régions productrices de pétrole.
La Banque du Canada a déjà réagi aux chocs pétroliers en réduisant ses taux d’intérêt de 50 points de base en 2015, lors de l’effondrement précédent des prix, mais la situation actuelle est très différente. Le choc de 2015 était plus fort (les prix pétroliers ont chuté d’environ 50 % tout au long de 2014) et les dépenses en immobilisations dans le secteur pétrolier et gazier représentaient une part beaucoup plus importante de l’économie qu’aujourd’hui.
Cette période a également été marquée par des changements structurels sur le marché. L’augmentation massive de la production pétrolière aux États-Unis a dépassé la croissance de la demande mondiale, ce qui s’est avéré beaucoup plus persistant que les fluctuations des risques géopolitiques.
À propos des auteurs
Nathan Janzen travaille à RBC depuis 2008, où il s’occupe principalement de la couverture des perspectives macroéconomiques du Canada et des États-Unis. Il est titulaire d’une maîtrise en économie de l’Université McMaster et d’un baccalauréat en économie de l’Université de Regina.
Claire Fan est économiste à RBC. Elle se concentre sur les tendances macroéconomiques et est chargée d’établir des prévisions relatives au PIB, au marché du travail et à l’inflation pour le Canada et les États-Unis, en fonction des principaux indicateurs.
Le présent article vise à offrir des renseignements généraux seulement et n’a pas pour objet de fournir des conseils juridiques ou financiers, ni d’autres conseils professionnels. Le lecteur est seul responsable de toute utilisation des renseignements contenus dans le présent document, et ni la Banque Royale du Canada (« RBC »), ni ses sociétés affiliées, ni leurs administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires respectifs ne seront tenus responsables des dommages directs ou indirects découlant de l’utilisation du présent document par le lecteur. Veuillez consulter un conseiller professionnel en ce qui concerne votre situation particulière. Les renseignements présentés sont réputés être factuels et à jour, mais nous ne garantissons pas leur exactitude et ils ne doivent pas être considérés comme une analyse exhaustive des sujets abordés. Les opinions exprimées reflètent le jugement des auteurs à la date de publication et peuvent changer. La Banque Royale du Canada et ses sociétés affiliées ne font pas la promotion, explicitement ou implicitement, des conseils, des avis, des renseignements, des produits ou des services de tiers.
Le présent document peut contenir des déclarations prospectives – au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières – qui font l’objet de la mise en garde de RBC concernant les déclarations prospectives. Les paramètres, données et autres renseignements ESG (y compris ceux liés au climat) contenus sur ce site Web sont ou peuvent être fondés sur des hypothèses, des estimations et des jugements. Les mises en garde relatives aux renseignements présentés sur ce Site Web sont exposées dans les sections « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » et « Avis important concernant le présent rapport » de notre Rapport climatique le plus récent, accessible sur notre site d’information à l’adresse https://www.rbc.com/notre-impact/rapport-citoyennete-dentreprise-rendement/index.html. Sauf si la loi l’exige, ni RBC ni ses sociétés affiliées ne s’engagent à mettre à jour quelque renseignement que ce soit présenté dans le présent document.